Laïcité, du principe à la culture
La décision du Conseil d’État d’annuler l’arrêté pris à Villeneuve-Loubet et concernant le « burkini », loin de ramener le calme en la matière, a relancé le débat politique. De nouveau, la notion de laïcité est au centre de la controverse, et l’on voit apparaître à son sujet des arguments pour le moins curieux, comme une assimilation au « racisme », ainsi que l’a fait l’historien Shlomo Sand dans les colonnes du Nouvel Observateur[1]. Que ce genre « d’argument » puisse surgir dans le feu de la polémique, on veut bien l’admettre et invoquer à son propos l’échauffement malsain des esprits. Qu’il puisse être invoqué par un homme d’habitude plus pondéré en dit long sur la confusion mentale qui saisit aujourd’hui une partie des « cerveaux » de la « gauche ». On voit bien ici l’effet de « point Godwin » que veulent imposer ceux qui utilisent ce type d’argument, cherchant à déconsidérer d’emblée leurs adversaires. Et il convient de dire que cet argument est doublement pervers, d’une part car il empêche le débat d’avoir lieu de manière sereine (ce qui est – normalement – le but que devrait viser in intellectuel) mais aussi parce que galvaudant le mot « racisme », il lui ôte sa précision et son efficacité, ce qui se révélera à l’usage dramatique quand nous serons confrontés à de véritables arguments racistes. A cela s’ajoute une liste d’arguments controuvés, qui font peine à lire et entendre, et qui ont été dénoncés avec vigueur par un journaliste québécois[2]. De ce point de vue, le texte de Jacques Julliard sur l’islamo-gauchisme[3], montre bien la dérive qui s’est opérée dans une partie de la « gauche » française, et insiste sur la position que ce principe de laïcité a comme « marqueur » politique.
Il faut donc rappeler, encore et encore, non pas tant pour convaincre des esprits qui, ayant abandonné toute capacité de raisonnement pour céder à la pression d’une idéologie s’en vont battre la campagne avec des arguments controuvés et de mauvaises fois, mais pour borner un débat au profit des gens raisonnables, ce qu’est la laïcité.
La laïcité est tout d’abord fondamentalement un principe politique. Ce principe politique a naturellement des incarnations juridiques, qui peuvent varier d’un pays à l’autre. Mais, ce principe fait aussi partie d’une culture politique spécifique, qui traduit les habitudes et les routines accumulées depuis des siècles en France. Cette culture politique constitue le langage commun que nous utilisons, que ce soit consciemment ou à notre insu, quand nous agissons en politique.
Ce sont donc ces trois dimensions que l’on va successivement examiner, en rappelant au passage pourquoi on ne peut fonder un principe que sur une nécessité fonctionnelle.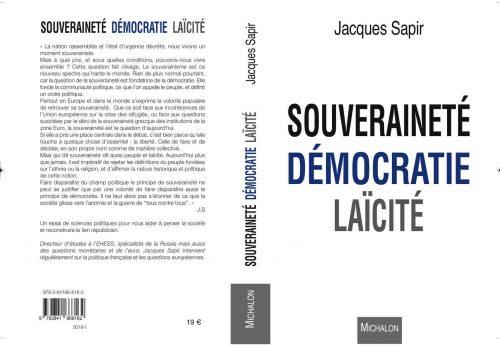
I. La laïcité comme principe politique
Un principe politique est une notion qui vise à organiser l’espace politique. De ce point de vue, la laïcité est un héritage direct des Guerres de Religion qui ensanglantèrent la France (et une partie de l’Europe) au XVI-XVIIe siècles. C’est pourquoi ce principe est formulé par les philosophes et juristes de cette époque comme Bodin ou Hobbes. Il dit que les querelles religieuses, qui ne sont pas du domaine de la Raison mais de la Foi, doivent être retirées de l’espace politique si l’on veut que ce dernier puisse traiter en raison des autres conflits qui le traversent.
- La fonction de ce principe est de permettre l’existence d’un corps politique, ce que l’on nomme « le peuple », alors que l’on est confronté à une hétérogénéité religieuse massive. Mais, cette fonction ne se comprend que si l’on a une vision de la souveraineté. Et il n’est pas innocent que les mêmes qui ont pensé la nécessaire relégation des religions hors de l’espace politique aient été des penseurs de la souveraineté. Cette souveraineté, dont on met l’origine dans Dieu, s’incarne en réalité dans le peuple. Que l’on se souvienne de l’adage romain : Vox populi, vox dei. Il est important, ici, de revenir à l’exemple romain, de la Rome républicaine comme de la Rome impériale. La structure du pouvoir législatif et judiciaire y est complexe. S’y articulent tant des formes populaires, les Comices centuriates et tributes, le concile de la Plèbe, que des formes aristocratiques comme le Sénat[4]. La complexité de ces formes a tendu à en obscurcir la logique. Cependant, il convient de distinguer l’exercice de la souveraineté, qui se fait dans des articulations susceptibles d’évoluer, de l’origine de cette souveraineté. Mario Bretone, dans un ouvrage de référence qui a été traduit de l’Italien récemment, cite le principe : « la Loi est le décret général du peuple ou de la plèbe sur la demande d’un magistrat» [5]. On retrouve cette idée sous l’empire. Dans la loi d’investiture de Vespasien (69-79 de notre ère), la fameuse « Lex de imperio Vespasiani », la ratification des actes de l’empereur avant son investiture formelle est dite « comme si tout avait été accompli au nom du peuple» [6]. On perçoit que l’origine de la souveraineté réside dans le peuple, même si ce dernier en a délégué l’exercice à l’empereur. Paolo Frezza parle de la « potestas nouvelle et extraordinaire » de l’empereur[7]. Ainsi, le principe de souveraineté populaire était déjà connu il y a de cela 2000 ans. Il est ici intéressant de constater la persistance du vocabulaire et des catégories républicaines au sein de l’empire[8]. C’est pourquoi je pense que même sous l’empire, c’est bien le peuple qui détient la souveraineté. L’empereur bénéficie d’une délégation, certes extensive, mais qui ne vaut pas cession. Il est un dictateur au sens romain du terme, qui peut s’affranchir de la légalité si nécessaire pour le bien de l’État et du « peuple » dans ce que l’on appelle des cas d’« extremus necesitatis » [9].
Cet espace politique alors défini conduit, progressivement, à la notion de Démocratie. Dès lors, et ceci sera explicite avec la Révolution de 1789, la laïcité a partie liée tant avec la démocratie qu’avec la souveraineté. Tel est d’ailleurs l’argument de l’un de mes livres[10], et c’est pourquoi je ne développe pas
Ce principe est consolidé dans l’égalité politique et juridique qui est reconnue à TOUS les citoyens, dans le Préambule de la Constitution. Ce Préambule proscrit toute distinction, que celle-ci soit basée sur le sexe, la « race » ou la religion. On peut donc légitimement considérer que le principe de laïcité se trouve à l’origine de cette extension qui constitue le « peuple » comme une communauté d’abord politique et que l’on retrouve dans notre Constitution.
- Le rôle de la laïcité se comprend dans la distinction entre une sphère privée et une sphère publique. Cette distinction, entre ces sphères, n’a été acquise que progressivement ; elle est fondamentale. C’est le nominalisme qui donne un véritable statut à la distinction entre « sphère privée » et « sphère public ». Le nominalisme apparaît avec Roscelin de Compiègne (fin du XIe siècle), et surtout Guillaume d’Occam et Jean Buridan au début du XIVe siècle. C’est un moment très important sur le plan politique : à partir du moment où l’on admet que des gens ne pensent pas comme nous, qu’ils ont le droit de ne pas penser comme nous, il y a une possibilité non pas encore de la démocratie mais déjà du pluralisme. Cette séparation entre les deux sphères est elle-même fluctuante, tant historiquement que géographiquement. Elle peut être remise en cause par des artefacts techniques et des technologies (comme aujourd’hui avec les « réseaux sociaux ») mais elle est absolument fondamentale à la démocratie. Rappelons-nous, alors, cet aphorisme anglais « sex and cult are privacy »[11]. Dès lors, on comprend aisément que toute pensée totalitaire, tout projet totalitaire, doit nécessairement remettre en cause cette distinction entre sphère privée et sphère publique comme préalable à l’asservissement des individus. Que cette remise en cause procède d’une irruption de la sphère publique dans la sphère privée (ce qui a caractérisé le nazisme et le stalinisme), ou que cette remise en cause procède de l’envahissement de la sphère publique par la sphère privée, ce qui correspond aujourd’hui aux revendications indentitaro-narcissiques, dont certaines des revendications religieuses font incontestablement partie.
La conséquence de l’affaiblissement de la séparation entre sphère publique et sphère privée réactive donc des choses très profondes, et en réalité très archaïques, dans notre société. Nous sommes une société de consommation, ce qui n’est pas condamnable puisque les gens sont mieux nourris et mieux soignés qu’ils ne l’étaient il y a un siècle. Mais cette société de consommation produit aussi l’idéologie consumériste qui ne conçoit pas les individus comme des membres d’un corps politique mais comme des gens qui demandent toujours plus de droits sans se demander s’ils empiètent sur les droits d’autrui. Il est alors frappant de voir des personnes qui sont parmi les premières à condamner le « société de consommation » reprendre en réalité l’un de ses produits les plus toxiques comme les revendications indentitaro-narcissiques qui fleurissent aujourd’hui sur les « réseaux sociaux » et qui s’affichent dans des postures vestimentaires, en confondant ces revendications et ces postures avec l’expression d’une « liberté » individuelle. Tel est l’un des ressorts de ce que Jacques Julliard dénonce dans ce qu’il appelle « l’islamo-gauchisme »[12].
Au « nous » qui était proposé par la République, mais qui perd progressivement de sa crédibilité car la République n’est plus souveraine, se substitue tout d’abord le « je ». Mais, devant la vacuité de ce « je », devant aussi son impuissance, on cherche à reconstruire un « nous », mais un « nous » particulier, excluant les autres. L’affirmation identitaire et narcissique fait ici le lit du fondamentalisme. Pourquoi donc ce retour en arrière dans le religieux ? Pourquoi y-a-t-il des voix qui, face aux victimes des crimes de janvier 2015, s’élèvent pour dire « ils ne l’ont pas volé », et qui de fait demandent implicitement le rétablissement de l’ignoble délit de blasphème ? Pourquoi y-a-t-il des voix qui, face au scandale et à la provocation que constituent le « burkini » s’obstinent à donner raison aux provocateurs ? La raison en est simple : parce que l’on récuse cette idée fondamentale de la souveraineté comme base de la démocratie.
- Les limites de ce principe apparaissent cependant clairement dans les limites de la distinction entre ces deux sphères. On comprend parfaitement que les individus agissent dans la sphère politique à partir de valeurs individuelles qui peuvent, dans certains cas, être d’origine religieuse. Ceci est parfaitement normal. Mais, quand ils agissent au nom d’une revendication agressive de ces valeurs, quand ils entendent imposer la reconnaissance d’individus en tant que membre d’une religion donnée, cela pose manifestement un problème, et l’on peut considérer qu’il y a en ce cas une contradiction claire avec le principe de laïcité. En effet, l’une des premières conséquences de cette dernière est de considérer que l’on intervient dans la sphère publique en tant que citoyens et non en tant que prosélyte d’une religion donnée. Et cela implique une distinction entre le « penser » et le « dire » car, et ce encore plus aujourd’hui où toute parole prend une dimension rapidement collective, il y a des moments ou « dire » c’est « agir ». Ce qui impose de réfléchir aux limites des libertés individuelles. Nous sommes tous, naturellement, attachés aux libertés individuelles et à la sphère privée. Pourtant, nous reconnaissons aussi comme légitime l’ingérence de la puissance publique dans la famille, que ce soit pour traiter des violences, des maltraitances, ou de problèmes dramatiques comme l’excision des petites filles. Les individus ne peuvent s’abriter derrière la notion de « choix personnel » ou de « sphère privée » pour commettre ces délits et ces crimes. Telle est la limite des libertés individuelles.
Il faut donc ici admettre que certaines valeurs individuelles sont contradictoires, et par là incompatibles, avec des principes politiques. Il y a même des valeurs individuelles, parfaitement admissibles au niveau de chaque individu, mais dont l’expression publique est susceptible de créer de graves troubles. De ce point de vue, il est bon de donner la parole à l’une des grandes figures du libéralisme, John Locke, qui écrivait au XVIIe siècle justement à propos des tenues vestimentaires associées à certaines religions (les sectes protestantes) : «Il est dangereux qu’un grand nombre d’hommes manifestent ainsi leur singularité quelle que soit par ailleurs leur opinion. Il en irait de même pour toute mode vestimentaire par laquelle on tenterait de se distinguer du magistrat [comprendre l’autorité civile] et de ceux qui le soutiennent ; lorsqu’elle se répand et devient un signe de ralliement pour un grand nombre de gens…le magistrat ne pourrait-il pas en prendre ombrage, et ne pourrait-il pas user de punitions pour interdire cette mode, non parce qu’elle serait illégitime, mais à raison des dangers dont elle pourrait être la cause?»[13].
- L’origine de ce principe est fondamentalement à rechercher dans l’expérience tragique des guerres de religion. Mais, on peut vouloir discerner dans l’affirmation de tout « principe de droit » une origine religieuse, et l’on sait que le droit, à l’origine, fut largement lié à la religion. Chaque fois que nous rencontrons un « principe », nous sommes confrontés en réalité à la notion de « lois intangibles » ou du moins de principes susceptibles de s’appliquer aux sociétés sur de très longues périodes, au point de paraître intangibles pour les membres de ces sociétés. Il faut se poser la question si ces « lois intangibles », relève du droit naturel, que ce soit dans sa version stoïcienne ou traditionnaliste, et peuvent structurer une communauté humaine, ou si les principes d’organisation ne découlent pas plus des contraintes que rencontrent les sociétés humaines. Pour Jean Bodin la nature est une réalité observable et elle n’est plus cette « donnée » à laquelle on devrait se conformer. Cette position signe l’acte de décès du droit naturel, du jusnaturalisme. Mais, en réalité, cela ne fait que retrouver la position de nombreux jurisconsultes romains à l’âge classique de la République en qui il trouve probablement son inspiration.
L’idée du droit naturel qui vient de la philosophie grecque, a été attaquée très tôt. Les jurisconsultes du temps des Guerres Puniques, à l’apogée de la République, sont très réservés à propos de cette idée. En fait le jusnaturalisme se développe à Rome de concert avec la réaction aristocratique dont Cicéron fut l’un des porte-paroles[14], et l’on peut soutenir qu’il a été une forme de défense des intérêts de cette réaction aristocratique. Le junaturalisme de Cicéron apparaît essentiellement pragmatique et instrumental et conçu pour soutenir ses convictions conservatrices. Il est cependant intéressant de constater le développement des théories du droit naturel au fur et à mesure que s’affirme la nature autocratique de l’empire (vers le 2ème siècle de notre ère) et où progresse le transfert de l’exercice de la souveraineté des institutions héritées de la République au seul Sénat, traditionnellement le noyau du pouvoir aristocratique[15]. De fait, plus on s’écarte de la vision traditionnelle qui place dans le peuple l’origine de la souveraineté, plus on fait référence au « droit naturel ». Cette tendance fut naturellement largement renforcée par la « conversion » de l’empire au christianisme. Elle correspond à la période ou le christianisme se montre d’ailleurs d’une extrême intolérance avec les autres croyances.
Or, cette idée de fonder dans la religion des principes politiques implique que l’on n’ait qu’une croyance dans la société. C’est d’ailleurs bien ce que disent les extrémistes religieux qui affirment la supériorité des « lois de Dieu » sur les « lois des hommes ». Mais, dès que l’on est en présence d’une hétérogénéité des croyances, ce type de position ne peut que conduire à la guerre civile. C’est pourquoi il convient de traiter ce type de position non comme une « opinion » comme il est légitime d’en avoir dans une société « ouverte » mais comme une opinion dont l’affirmation publique, parce qu’elle devient en fait exclusive de toute autre, est susceptible de provoquer de graves troubles à l’ordre public. La question de la séparation entre ce que certains appellent la « cité de Dieu » (et ce quel que soit le Dieu qu’ils honorent) et la « cités des hommes » devient un point de clivage essentiel si l’on veut préserver la paix civile.
Dans une société marquée par l’hétérogénéité profonde des croyances (et des croyances religieuses) on constate que la seule solution possible est celle qui consiste à fonder les principes sur des nécessités fonctionnelles. Le principe de souveraineté, il faut le rappeler se fonde sur ce qui est commun dans une collectivité, et non pas uniquement sur celui qui exerce cette souveraineté[16]. Le besoin de souveraineté s’exprime en l’absence de l’autorité l’exerçant, il est produit par le fonctionnement de la société. Cela a été perçu clairement par Jean Bodin dont la thèse théorique est qu’il n’y a de république en général que s’il y a souveraineté, sachant que celle-ci existe légitimement dans le roi, les seigneurs, le peuple. C’est là, la thèse réellement fondatrice de l’État moderne.
Ceci conduit à aborder le principe de densité sociale. Il a été mis à jour par Emile Durkheim qui analyse l’existence et les conséquences de ce qu’il appelle la densité matérielle et la densité dynamique des sociétés[17]. Ce principe provient de la constatation que dans une société où les acteurs sont à la fois séparés et interdépendants, toute action initiée individuellement peut avoir des effets non-intentionnels sur autrui.
C’est pourquoi l’origine des principes, comme la laïcité ou le principe dérivé de non-ségrégation, est à chercher dans ce que j’ai appelé dans plusieurs ouvrages « l’ordre démocratique »[18], qui est une nécessité fonctionnelle des sociétés modernes. On peut vouloir en parallèle chercher une origine dans une philosophie ou une religion si on le souhaite. Mais il faut comprendre que cette origine ne sera légitime que pour ceux qui partagent cette croyance (et je range l’athéisme au sein des croyances). Si l’on veut fonder une origine en des termes qui soient acceptables par l’ensemble des croyances, il faut alors reconnaître la très grande force de la nécessité fonctionnelle.
L’intérêt public n’est pas la condition permissive de la démocratie, mais au contraire l’ordre démocratique est la procédure qui permet la constitution d’une représentation de l’intérêt public. Il n’y a donc pas, comme le croyaient les pères fondateurs des régimes démocratiques modernes au XVIIIème siècle un intérêt public « évident » et donc naturellement partagé par tous. Mais, parce que nous sommes dans des sociétés dominées à la fois par la décentralisation et par l’interdépendance, nous avons besoin d’un intérêt public comme norme de référence pour combattre les tendances spontanées à l’anomie et à la défection. L’ordre démocratique est donc aux antipodes de la vision idéaliste de la démocratie qui croit voir dans cet intérêt public le produit d’un ordre naturel; cet intérêt public ne peut, en réalité, qu’être une construction sociale. L’ordre démocratique est donc la condition du bon fonctionnement d’une société combinant à la fois la décentralisation (au sens où des actions pouvant contribuer au bonheur de tous sont initiées séparément) et la densité (au sens utilisé par Durkheim), l’hétérogénéité radicale des participants et la nécessaire convergence des représentations, le tout dans le respect de la contrainte temporelle (une décision n’a de sens que si elle est prise avant que ses effets ne soient obsolètes). L’ordre démocratique est donc une nécessité fonctionnelle pour des sociétés soumises à de telles contraintes.
II. L’ordre démocratique comme nécessité fonctionnelle des sociétés modernes et ses conséquences
Nous vivons aujourd’hui dans des sociétés où l’économie, conçue comme une activité de coordination, autrement dit comme la mise en commun, consciente ou inconsciente, d’activités initiées séparément et par des acteurs eux-mêmes séparés, est dominante. Cette mise en commun peut se traduire par des additions de bien être, tout comme elles speuvent aussi se traduire par de nouveaux problèmes (les « externalités négatives », la pollution, etc…). Cette mise en commun doit donc être pensée même si certaines de ces formes sont à laisser à des routines de comportement[19]. Cela impose de penser les conditions les plus propices à cette coordination.
Les tentatives pour penser l’organisation de la société soit dans un cadre entièrement hiérarchique soit dans un cadre parfaitement décentralisé, ont toutes échoué. Cela impose de penser quel cadre permettrait le mieux à ces formes de coordinations qui sont nécessaires, qu’elles soient intentionnelles ou non-intentionnelles, qu’elles soient conscientes ou inconscientes, d’émerger. Telle est la raison fondamentale qui amène à la formulation de ce que l’on a appelé « l’ordre démocratique ». La notion d’ordre démocratique permet de retrouver une pensée de l’action en société qui soit efficace parce que démocratique et donc n’excluant personne et aucune forme institutionnelle. L’ordre démocratique est une notion construite au confluent d’une analyse réaliste, ni formaliste ni métaphysique, du droit et de l’économie. Être républicain aujourd’hui, au sens vouloir la « chose publique » ou Res Publica implique comprendre la démocratie comme un espace collectif par lequel ces libertés individuelles prennent sens dans leur contribution à l’émergence de représentations communes et de décisions légitimes.
- Routines, clauses structurelles et règles de droit
C’est à Herbert Simon, que nous devons le rappel de cette évidence[20] : nous utilisons des routines, tant que nous sommes raisonnablement persuadés de leur fiabilité. Que survienne un événement qui nous surprenne et ces routines sont mises en cause. Ensuite, nos préférences ne sont pas données une fois pour toutes; elles sont dépendantes des contextes et sont sensibles à la fois à la durée de nos expériences à l’ordre dans lequel les termes d’un choix nous sont présentés[21]. Nos décisions dépendent des contextes au sein desquels nous évoluons. Car, et c’est bien ce qui rend vain toute idée de déterminisme absolu, direct ou tendanciel, nous évoluons simultanément dans plusieurs contextes. Bien entendu il nous faut produire une représentation des hiérarchies entre ces contextes, de la nation à la famille en passant pas les diverses structures collectives qui structurent nos activités sociales.
Ceci renvoie à une incompréhension de certains mécanismes politiques. Dans une Constitution, on trouve en même temps des clauses structurelles et des clauses de droit[22]. Les clauses structurelles visent à l’organisation de l’espace de débat; elles concernent les modalités d’élection, de vérification, de fonctionnement du système politique au sens le plus réduit du terme. Ces clauses sont très certainement des règles organisatrices, qui évitent que certaines questions soient interminablement rediscutées à chaque occurrence. Ainsi en est-il du mode de scrutin. Il est parfaitement légitime de débattre régulièrement du mode de scrutin, et ce dernier peut être modifié.
Ceci était bien vu par des auteurs comme T. Jefferson ou J. Locke pour qui les décisions d’une génération ne pouvaient lier la suivante[23]. Mais, en le mettant dans une Constitution, on évite de le voir rediscuté à chaque nouvelle élection. Les clauses de droit visent, elles, à exclure de la sphère du choix majoritaire certaines décisions, dans le but de protéger les droits individuels. Il est clair que, chez Hayek, on a une confusion entre ces deux dimensions d’une Constitution, entre clauses structurelles et clauses de droit. Si, maintenant, on regarde la question des clauses de droit, on peut les considérer de manière essentialiste ou fonctionnaliste. La tradition libérale s’appuie en général sur une interprétation essentialiste; les droits à protéger sont ceux qui découlent d’une nature humaine intangible et pré-éxistante à toute société. Mais, ceci entre rapidement en conflit avec la notion de « clause structurelle », qui induit, au nom de la non-saturation des capacités cognitives des acteurs des règles d’omission.
L’analyse que S. Holmes propose de la Constitution américaine montre que certaines de ces règles d’omission sont déstabilisantes (par exemple la tentative de faire omettre toute discussion sur l’esclavage), tandis que d’autres sont stabilisantes[24]. L’exemple qu’il donne de la « bonne » règle d’omission, la neutralité du système politique quant aux croyances religieuses, éclaire alors la distinction entre « bonne » et « mauvaise » règle d’omission. Toute règle qui tend à pérenniser une discrimination, ou un mode de coordination est mauvaise; toute règle qui laisse les agents libres de leurs mode de coordination est bonne.
Ainsi, ce n’est pas la protection de la sphère privée qui est ici pertinente. Les partisans de l’esclavage avaient formellement raison de prétendre que si le Congrès américain s’autorisait à statuer sur cette question il violerait un droit de propriété. Ils avaient doublement tort en ne considérant pas l’incompatibilité qu’il y a à prétendre construire une société libre sur un principe d’asservissement, et en ne comprenant pas que toute tentative pour empêcher la politique de résoudre cette question inviterait alors à ce que l’on use des armes.c
« Si les avantages d’une limitation des ordres du jour sont substantiels, en particulier dans des sociiétés divisées, ils sont en règle générale accompagnés de défauts significatifs. La Democratie n’est pas seulement rendue possible, mais elle est aussi rendu imparfaite, par une réduction systématique des questions sous le contrôle majoritaire. (…) Les règles d’omission, qui plus est, sont rarement neutres; elles soutiennent implicitement une politique et minent les alternatives. Supprimer une question peut assurer subrepticement la victoire d’un parti sur ses rivaux. Enfin, les stratégies d’évitements peuvent exacerber l’explosion des tensions sociales, engendrer éventuellement le terrorisme ou une explosion révolutionnaire en niant l’expression légitimes de croyances trop profondéments enracinées« [25].
Ainsi que l’indique Stephen Holmes, il est illusoire de croire que le contenu d’une Constitution puisse être entièrement « neutre », au sens que lui donne Hayek[26]. S’appuyer alors sur des règles constitutionnelles pour limiter la sphère du pouvoir majoritaire est fondamentalement destabilisateur pour la société.
- La notion d’ordre démocratique
L’ordre démocratique, comme conception matérialiste et réaliste, envisage alors la démocratie ni comme la somme de libertés individuelles préexistantes à la mise en société ni comme un simple cadre permettant l’expression d’une opinion politique, religieuse ou commerciale. L’ordre démocratique se veut une justification fonctionnelle, faisant l’économie de toute hypothèse métaphysique, et entièrement cohérente avec les fondements d’une approche réaliste, des principes devant guider la construction des règles d’organisation. L’ordre démocratique a, alors, deux fondements. Il est d’abord une chaîne logique qui découle de la notion de souveraineté du peuple et des contraintes qui en découlent quant aux possibilités de dévolution. La souveraineté du peuple est première. Il est ensuite une réponse au fait que la coordination de décisions décentralisées, dans une société répondant au principe d’hétérogénéité, implique que des agents ayant des positions inégales se voient mis dans une position formelle d’égalité. Le couple contrôle/responsabilité résulte ainsi du principe de densité; il en est une manifestation. Il implique alors que le peuple soit identifié à travers la détermination d’un espace de souveraineté. C’est pourquoi l’ordre démocratique implique des frontières (qui est responsable de quoi), mais aussi une conception de l’appartenance qui soit territoriale (le droit du sol). L’absence de frontières, l’indétermination de la communauté de référence, découplent le contrôle de la responsabilité.
L’ordre démocratique envisage les systèmes démocratiques concrets en action comme des ensembles de procédures permettant:
- Le dégagement de convergences dans les représentations et d’une convergence entre ces représentations et la réalité, à travers des systèmes emboîtés d’espaces de controverse.
- La légitimation des systèmes de règles et de sanctions qui permettent à ces espaces de fonctionner, en référence aux principes démocratiques.
La loi démocratique n’a donc pas à être complète, et par cela n’a pas à être parfaite; elle est constament améliorable dans un système qui laisse la place à la création. L’autorité de la loi n’est donc pas une construction formelle, mais la traduction d’un principe de souveraineté. La loi est légitime non pas seulement ou uniquement parce qu’elle est l’expression d’une majorité, mais parce qu’elle a respecté tout à la fois des procédures et des principes. La présomption légale de la majorité ne confère ainsi nullement la légitimité à ses décisions.
Abandonner l’idée d’un usage normatif de la liberté individuelle, resituer la notion de liberté de l’individu dans son contexte social, telles sont les démarches qui permettent d’appréhender l’ordre démocratique. Ce dernier se veut une solution aux problèmes soulevés par C. Schmitt sur la « présomption légale » qui condamnerait la démocratie[27]. Dans la démocratie parlementaire parfaite, le pouvoir a cessé d’être celui des hommes pour devenir celui des lois. Mais, les lois ne “règnent” pas ; elles s’imposent comme des normes générales, on pourrait dire de manière « technique » aux individus. Dans un tel régime, il n’y a plus de place pour la controverse et la lutte pour le pouvoir et pour l’action politique. “ Selon le principe fondamental de la légalité ou conformité à la loi, qui régit toute l’activité de l’État, on arrive en fin de compte à écarter toute maîtrise et tout commandement, car ce n’est que d’une manière impersonnelle que le droit positif entre en vigueur. la légalité de tous les actes de gouvernement forme le critère de l’État Législateur. Un système légal complet érige en dogme le principe de la soumission et de l’obéissance et supprime tout droit d’opposition. En un mot, le droit se manifeste par la loi, et le pouvoir de coercition de l’État trouve sa justification dans la légalité“[28]. Le légalisme est ainsi présenté comme un système total, imperméable à toute contestation. C’est ce qui permet, ou est censé permettre à un politicien de prétendre à la pureté originelle et non pas aux mains sales du Prince d’antan[29].
- Egalité originelle et construction de l’égalité
L’ordre démocratique oppose la notion de construction de l’égalité à celle de l’égalité originelle. Il refuse la confusion entre un idéal et une démarche analytique qui caractérise aujourd’hui de nombreuses théories. Il n’est donc pas simplement le produit de la chaîne logique évoquée ci-dessus, mais aussi le produit de la posture méthodologique en faveur du réalisme.
Cette confusion, qui est au coeur même des traditions idéalistes de la démocratie, porte en elle le risque de politiques tentant d’homogénéiser de force une réalité hétérogène. La grande erreur du libéralisme politique est d’avoir confondu le couple construction formelle/état de nature et le couple construction formelle/état réel de la société. Les individus sont divers et hétérogènes; pour autant si ils ne peuvent également participer à l’élaboration des diverses formes de coordination, locales et globales, c’est la communauté dans son ensemble qui sera lésée. Reconnaître les différences ce n’est pas éterniser ces différences mais au contraire se donner les moyens de penser la construction des convergences et des règles communes qui doivent permettre la participation de tous aux activités concernant tous. L’hétérogénéité sociale ex-ante fixe donc comme objectif à l’ordre démocratique la construction d’une homogénéité politique ex-post, et ce dans des sociétés traversées d’intérêts contraires.
L’intérêt public n’est pas la condition permissive de la démocratie, mais au contraire l’ordre démocratique est la procédure qui permet la constitution d’une représentation de l’interêt public. Il n’y a donc pas, comme le croyaient les pères fondateurs des régimes démocratiques au XVIIIème siècle un intérêt public « évident » et donc naturellement partagé par tous. Mais, parce que nous sommes dans des sociétés dominées à la fois par la décentralisation et par l’interdépendance, nous avons besoin d’un intérêt public comme norme de référence pour combattre les tendances spontanées à l’anomie et à la défection. L’ordre démocratique est donc aux antipodes de la vision idéaliste de la démocratie qui croit voir dans cet intérêt public le produit d’un ordre naturel; il ne peut, en réalité, qu’être une construction sociale.
L’ordre démocratique est donc enfin la condition de bon fonctionnement d’une société combinant décentralisation et densité, hétérogénéité des participants et nécessaire convergence des représentations, le tout dans le respect de la contrainte temporelle. L’ordre démocratique est donc aussi une nécessité fonctionnelle pour des sociétés soumises à de telles contraintes.
- Les règles et les principes de l’ordre démocratique
De la souveraineté du peuple découlent alors une règle de dévolution, et trois principes qui fondent le droit de l’ordre démocratique. On peut formuler ces derniers de la manière suivante:
- Nul ne peut prétendre au contrôle sans endosser une responsabilité des actes issus de son contrôle. La garantie que tous accordent au contrôle de un s’accompagne de la responsabilité de un devant tous. La souveraineté nationale est alors le garant ultime de l’exercice de nos droits, comme l’exprimait la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Constitution de 1793.
- Nul ne peut fixer seul un mode de coordination, ou exclure de ce mode certaines formes ou certains participants de la communauté. C’est là la conclusion logique qu’il faut tirer de l’hypothèse de connaissance imparfaite. Les discriminations fondées sur l’être de l’individu ou sur son origine sont par nature nulles et non avenues. Aucun système politique, qu’il soit local ou national, ne peut être fondé sur des différences culturelles, religieuses, sexuelles ou autres.
- Nous avons tous, au sein d’une même communauté qui ne peut être que territoriale, le même droit à participer à la constitution, intentionnelle ou non, des modes de coordination.
Les formes politiques qui, dans une société à la fois décentralisée et interdépendante, ne respecteraient pas ces trois principes seraient illégitimes car incohérentes avec l’état de la société et non-fonctionelles. Les lois tirent alors leur légitimité des formes politiques dans lesquelles elles sont élaborées, tout autant que de leur respect de ces trois principes.
Dès lors, on comprend sans peine pourquoi le principe de laïcité est lié à l’ordre démocratique, pourquoi ce dernier est l’origine de ce principe. Le fait de constituer l’espace politique comme un espace dégagé des principes religieux, ou à tout le moins où ces principes ne peuvent s’exprimer qu’avec « discrétion » est une nécessité si l’on veut que soient respectées les règles de non-discrimination qui sont nécessaires à la garantie que tous accordent au contrôle de un s’accompagne de la responsabilité de un devant tous.
L’ordre démocratique est une notion qui implique une rigueur nouvelle dans la conception des institutions. Elle ne conduit nullement à un quelconque nihilisme institutionnelle, au refus de toute intermédiation au nom de la sanctification de la démocratie directe. Parce qu’il s’agit d’une notion élaborée dans le cadre d’hypothèses méthodologiquement réalistes, l’ordre démocratique intègre les problèmes posés par la limitation des capacités cognitives des individus, par la nature sociale et exogène de l’expression de leurs préférences. L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie, de leur donner un nom, mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté.
L’ordre démocratique permet de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques. Ceci ne veut pas dire que tout soit politique et rien technique. La seule position cohérente ici consiste d’une part à déterminer des critères permettant de distinguer ce qui relève du politique et ce qui relève du technique, et d’autre part de juger de chaque domaine au cas à cas en utilisant ces critères. C’est justement ce que permet la notion d’ordre démocratique.
III. Les incarnations juridiques du principe politique de laïcité
On a tendance à confondre d’une part un principe politique, autrement dit une règle organisatrice de l’espace politique avec ses incarnations juridiques, qui sont largement contextuelles et d’autre part à ne voir comme « incarnation » que la loi de 1905. Or, cette dernière, dans un contexte particulier, ne fait qu’organiser les règles de séparation entre les églises et l’Etat. Elle n’est donc nullement une loi de laïcité comme on le prétend parfois. Par ailleurs, la notion d’état de droit soulève en réalité de nombreux problèmes et ne peut être reçue comme un « absolu ». Car, cette notion renvoie au couple qui existe entre la légalité et la légitimité. Le Droit est aussi politique ; l’arrêt du Conseil d’Etat en ce qui concerne le « burkini » nous le rappelle.
- Droit et politique
L’arrêt du Conseil d’Etat n’est pas la première ou la seule occurrence d’une décision de droit qui semble politiquement motivée. Il y a eu de nombreuses occasions où une cour a rendu un jugement, puis fut amenée à se déjuger par la suite, en tout ou partie. On peut ici rappeler le jugement de la Cour Suprême des Etats-Unis concernant les lois prises dans le cadre du New Deal. Le Président F.D. Roosevelt ayant été réélu en 1936, il nomma des juges favorables à sa politique et la Cour Suprême avalisa ce qu’elle avait condamné. Le Conseil d’Etat avait rendu un arrêt défavorable à l’interdiction du voile à l’école (1989) quand cette interdiction avait été prise par des autorités administratives, mais une loi fut votée et le Conseil d’Etat s’en tint là. Rappelons encore que le Conseil d’Etat ne juge que de la conformité d’une décision administrative avec une loi ; il est donc faux de prétendre qu’il « dit le droit » au sens où l’on pourrait le dire du Conseil Constitutionnel. De plus, même dans le cas du Conseil Constitutionnel, il faut rappeler que sa jurisprudence admet qu’une décision de droit validée dans le cadre d’un référendum, lui échappe. Ceci n’est que la traduction concrète du vieux principe romain « vox populi, vox Dei », qui indique bien qu’en dernière instance c’est le Souverain (donc le peuple ) qui fait le droit. Ce principe fondamental de la souveraineté doit alors être rappelé pour indiquer les limites de la compétence du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, le principe dit d’état de droit se trouve largement pollué par le positivisme juridique, et peut conduire à des situations où la lettre du droit s’oppose directement à son esprit. Il faut donc éviter de fétichiser l’état de droit ou la « rule by law ». Le positivisme échoue car il ne prend pas l’exception, ou les dimensions contextuelles, assez au sérieux. Il persiste à concevoir les détentions et les dérogations comme des actes parfaitement « légaux », concrétisant des normes plus générales et tirant d’elles leur autorisation sans s’interroger sur l’origine, ou la conformité à des principes répondant à des fonctionnalités, de ces dites normes.
On peut donc, à la suite de David Dyzenhaus, comprendre comment l’obsession pour la rule by law (i.e. la légalité formelle) et la fidélité au texte tourne bien souvent à l’avantage des politiques gouvernementales quelles qu’elles soient. À quelques reprises, l’auteur évoque ses propres analyses des perversions du système légal de l’Apartheid[30] en rappelant que cette jurisprudence avilissante tenait moins aux convictions racistes des juges sud-africains qu’à leur « positivisme »[31]. L’état de droit, ici, se faisait l’allié d’un système raciste. De même dans une théocratie, l’imposition de lois religieuses serait parfaitement « légal » même si l’on comprend que ces lois diviseraient profondément la société et seraient des sources d’inégalités et d’oppression tout à fait évidentes.
La véritable question n’est donc pas celle du respect formel de la légalité, question qui a sa pertinence mais sous réserve d’autres questions, que celle de savoir si les principes de non-discrimination, et donc le principe de laïcité, ont bien été respectés dans ce qu’il faut appeler « l’affaire du burkini ». D’une manière générale, cela renvoie à la question de la légitimité d’une norme, question qui est le surplomb naturel de la légalité. Cette légitimité ne peut être définie par la simple légalité, car cela équivaudrait à dire que TOUTE norme prise dans les formes légales serait légitime. L’histoire de la France au XXe siècle contient bien le cas d’un régime, celui de Vichy, dont les formes étaient légales mais qui fut considéré comme illégitime. A l’inverse nous avons le cas de la France Libre et du Général de Gaulle du 18 juin à la mise en place de l’assemblée consultative provisoire d’Alger réunie à partir de novembre 1943[32], qui correspond à une légitimité même si les formes légales n’avaient pas été respectées. C’est cette légitimité qui a fait que les décisions de la France Libre ont prévalu juridiquement sur celle du régime de Vichy. Nous avons le précédent de l’ordonnance du 9 août 1944 qui déclara illégal tous les actes du gouvernement de Vichy[33]. On sait que le Général de Gaulle avait contesté la légitimité du régime de Vichy dès le début, et en particulier lors du discours qu’il tint à Brazzaville le 27 octobre 1940[34]. Dès lors, aucun des textes de Vichy ne pouvait se parer des attributs de la légalité qui n’était qu’une apparence, car le régime était dépourvu de la légitimité. C’est ce que devait constater l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944, qui organisait l’extinction des actes de Vichy, une extinction qui devait, pour les actes non mentionnés à l’article 2 de l’ordonnance, être expressément constatée[35]. Cet article décrit le régime de Vichy comme « l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’État français » », récusant de fait sa légalité. Inversement, les actes pris par le gouvernement de la France Libre, en dépit de leur caractère souvent précaire, doivent être considérés comme des actes légaux. La précarité de ces textes ne peut être invoquée pour leur refuser le statut de « loi » au vu du vieil adage « nécessité fait loi »[36].
Ceci montre bien que la légalité d’une décision découle de la légitimité de qui prend cette décision, et que la vérification en légalité doit être seconde par rapport à la nécessité de la légitimité.
- La loi de 1905
La loi de 1905 ne fait qu’organiser la séparation des églises et de l’Etat[37]. Mais, pour ce faire, elle est amenée à préciser un certain nombre de limites à l’action des religions dans la sphère publique. De ce point de vue, la loi de 1905 va plus loin que la simple affirmation de la neutralité de l’Etat.
Il convient tout d’abord de rappeler que la loi de 1905, dans sa formulation actuelle, stipule bien que le « libre exercice des cultes » se fait sous réserve de « l’intérêt de l’ordre public ». Il est intéressant ici de rappeler les divers articles de la loi :
« Article 1 La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Ou encore :
« Article 25 ; Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. »
Ainsi, si la municipalité de Villeneuve-Loubet voulait ré-intervenir sur cette question, elle devrait le faire pour un temps limité et en précisant que l’arrêté est pris pour des motifs d’ordre public. C’est d’ailleurs ce que firent les maires de Cannes ou de Sisco.
Une lecture attentive de la loi de 1905 révèle aussi que la discussion sur les mosquées dites « salafistes », voire l’idée d’interdire le « salafisme » (qui est loin d’être le seul à poser problème), est largement sans objet. Le respect strict des articles de la loi de 1905 couvre la quasi-totalité des cas de figure. Tout d’abord, en ce qui concerne la tenue de discours politiques de haines ou pro-Djihadiste, nous avons l’article 26 :
« Article 26 : Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte. »
De même en ce qui concerne les « prières de rue », le point est traité par l’article 27.
« Article 27 Modifié par Loi n° 96-142 du 21 février 1996 (V) :Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. (…) »
Enfin, le cas des « prêcheurs de haine », autrement dit de personnes se réclamant de l’exercice du culte pour tenir des propos haineux ou diffamatoires envers quiconque (et les femmes ou les minorités sexuelles sont à l’évidence concernées), on conseille la lecture de l’article 34 :
« Article 34 Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 1 (V)
Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 3 750 euros. et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit. »
De même, la provocation, ou l’appel à provocation, quand il est le fait d’un religieux ou qu’il se produit sur un lieux de culte, tombe sous le coup de la loi, ainsi que le précise l’article 35 de la loi de 1905 :
« Article 35 : Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile ».
On pourrait durcir les peines, les accompagner d’interdiction du territoire, mais l’ensemble de l’arsenal légal est d’ores et déjà en partie présent. En fait on peut légitimement considérer que des prêches ou des appels dans des lieux de cultes (et aujourd’hui des mosquées) constituent bien des appels qui tendent à « soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres ». C’est en particulier vrai pour tout ce qui touche à l’intolérance religieuse, aux interdits alimentaires et aux prétendues obligations vestimentaires. On comprend ici que ce qui fait actuellement défaut c’est bien la volonté politique de faire respecter la loi et non la loi elle-même.
- Faut-il légiférer sur le « burkini » ?
Il est aujourd’hui évident que loin d’apporter le retour au calme souhaitable, la décision du Conseil d’Etat ne laisse pas d’autres solutions que celle d’une loi spécifique. Ce n’est pas la meilleure solution, car la question du « burkini » relève à l’évidence du contexte, et devrait être laissée à l’appréciation des autorités administratives. Mais, la décision du Conseil d’Etat ne laisse pas d’autre choix, dans la mesure où les provocations vont se multiplier et s’amplifier. Ces provocations vont engendrer nécessairement des réponses, qui seront toutes aussi détestables, directement ou indirectement, que ce à quoi elles réagissent. Il convient ici de rappeler que, selon les sondages, une majorité absolue de Français (64%) s’oppose à ce vêtement, alors que seuls 6% des Français l’approuvent[38]. Ceci ne fait que plus ressortir le déséquilibre entre l’arrêt du Conseil d’Etat, qui aurait dû pacifier l’opinion, et l’état de cette même opinion. Il est donc clair que le Conseil d’Etat a commis ici un pas de clerc…
Il convient donc de rappeler ici le contexte général :
- La France fait l’objet de tests de la part d’une petite minorité qui cherche à imposer une discrimination visible à la fois entre ce que cette minorité considère comme des « bons » et des « mauvais » pratiquants de sa religion mais aussi une discrimination visible entre homme et femme. Le vêtement est ici clairement un prétexte à stigmatisation de la part d’une minorité à l’encontre d’une majorité.
- Le port d’un certain type de vêtements s’inscrit aujourd’hui clairement dans un projet politique d’affirmation explicite d’un culte et de prosélytisme de ce dernier sur la voie publique. A cet égard, il est donc clair que nous sommes en présence d’une affirmation agressive d’une religion par rapport à l’espace public.
- Cette volonté d’imposer une discrimination visible s’inscrit dans une affirmation identitaire de nature communautariste. On voit que si l’on cède sur ce point ressurgiront immédiatement d’autres revendications comme celles de non-mixité ou de refus de certaines disciplines à l’école. Il est, de ce point vue, étonnant (ou pas…) qu’une certaine « gauche » dénonce (et avec raison) les revendications identitaires quand elles proviennent d’une certaine aile de l’arc politique mais accepte celle émise par une fraction, clairement extrémiste, se réclamant de l’Islam.
- L’habillement est soumis à des règles, qu’elles soient dites « de mœurs » ou « d’ordre public ». Ainsi, il est interdit de se promener en ville en maillot de bain, de même que l’affichage d’un prosélytisme outrancier est strictement réglementé. Il convient de rappeler l’existence de ces règles.
- Il faut alors rappeler que l’interdiction du port d’un vêtement n’est pas le symétrique de l’obligation de porter un type spécifique de vêtement. En effet, une personne peut porter des milliers de types de vêtements. Le fait de ne pas pouvoir en porter un ne lui ôte pas la possibilité de porter les autres. De ce point de vue les comparaisons faites entre l’interdiction du « burkini » (ou de la « burqa ») et l’obligation faites par les hitlériens du port de l’étoile jaune ne sont pas simplement stupides, elles sont aussi injurieuses pour la mémoire des victimes de la persécution nazie.
Ces motifs laissent à penser qu’une loi pourrait donc être prise, condamnant le port de vêtements qui constituent, dans le contexte actuel, de véritables manifestes politico-religieux. Cela n’implique pas d’aller au-delà. La loi, tout comme la tradition républicaine, tolère les signes d’appartenance religieux que l’on qualifiera de « discrets » tout comme elle distingue les habits des ministres des cultes de ceux du tout venant. Si une loi devait donc être prise, il conviendrait qu’elle respecte cette tradition.
Le point important est donc qu’« il n’y a pas de parti politique du royaume de Dieu ». Nous voyons bien à quel point c’est aujourd’hui une idée fondamentale. Cette idée doit se traduire dans le droit. Elle signifie à la fois que l’on ne peut prétendre fonder un projet politique sur une religion, et que la démarche du croyant, quel qu’il soit, est une démarche individuelle, et de ce point de vue elle doit être impérativement respectée, mais qu’elle ne s’inscrit pas dans le monde de l’action politique qui est celui de l’action collective. C’est ici une des fondations de la laïcité. Cependant, comment devons-nous réagir face à des gens qui, eux, ne pensent pas ainsi ? Soit ils considèrent que le « royaume de Dieu » peut avoir un parti politique (et on l’observe des intégristes chrétiens aux Etats-Unis aux Frères Musulmans) soit qu’ils considèrent que les deux cités, pour reprendre Augustin[39], sont sur le point de fusionner, comme c’est le cas de courants messianiques et millénaristes comme les salafistes ou d’autres courants millénaristes. On voit bien ici le problème. Ces courants, pour des raisons différentes, contestent – par des méthodes elles aussi différentes – l’idée même de laïcité. Or, cette idée est essentielle à la formation d’un espace politique, qui est certes traversé d’intérêts et de conflits, mais néanmoins gouverné par des formes de raison, espace politique indispensable à la construction de la souveraineté et de la nation. Faut-il donc les laisser faire, au nom des libertés individuelles qui sont une application de la raison, en sachant qu’ils sont porteurs de principes absolument antagoniques qui, s’ils triomphaient, rendraient impossible l’existence de ce type d’espace politique – et donc les libertés individuelles – au nom desquelles, en particuliers ceux qui considèrent que le « royaume de Dieu » peut avoir un parti politique, prétendent avancer ? La question est moins compliquée avec les courants qui prétendent à la fusion entre les « deux cités ». Ceux-là, en un sens, se mettent directement hors-jeu. Mais il convient aussi de trouver les formes légales permettant de combattre les courants qui en apparence font allégeance aux règles (dans le sens du positivisme juridique le plus strict) pour en combattre en fait le contenu. Cela montre que la question de la laïcité n’est pas seulement politique et juridique, mais que cette question a aussi une nature culturelle. L’oubli de cette dimension, venant avec les contre-sens sur la nature politique du principe de laïcité et sur ses applications juridiques, explique dans une large mesure les discours à proprement parler « aberrants » que l’on a pu entendre sur ce sujet depuis ces dernières semaines.
IV. La laïcité comme élément central de la culture politique
On a dit, au début de ce texte, que la laïcité fait partie d’une culture politique spécifique. Il y a aujourd’hui un certain nombre de points de vue qui insistent sur la dimension culturelle de la laïcité, comme le montrent les différents textes de Mathieu Bock-Côté[40] qui vont aborder le problème du multiculturalisme[41]. Mais, ces références à une « culture » peuvent poser problème selon que l’on confond un mot dans son usage commun et dans son usage savant. Il faut donc commencer par comprendre pourquoi nous avons besoin d’une culture politique unifiée et quels sont les liens que cette culture politique entretient avec les différents déterminants des cultures qui nous sont propres. Cela conduit alors à revenir sur la notion d’intégration et sur celle d’assimilation, notions qu’il convient de ne pas confondre, et qui sont – elles aussi – liées à la notion de « peuple » conçu comme corps politique. Au-delà, on devine que cela va nous entraîner à parler d’identité, mais dans un sens bien différent de l’usage fait de ce mot par des politiciens, qu’il s’agisse de Nicolas Sarkozy ou d’Alain Juppé.
- Culture politique et langage commun
La culture politique regroupe l’ensemble des règles (explicites et implicites) et des habitudes de comportement qui permettent aux liens politiques de se tisser. En cela elle est bien un « langage commun » qui doit être également partagé par l’ensemble des citoyens s’ils veulent pouvoir participer à l’espace politique.
Ce « langage commun » est aussi un langage, avec ce que cela implique comme impossibilité radicale de traduction de certains concepts dans une autre langue. Si nous comparons « laïcité » et le terme utilisé en anglais, « secularism », il y a une large différence entre les deux. On peut le comprendre dans la mesure où les images, qui sont le fruit du passé et des luttes antérieures, ne sont pas les mêmes. Bien sûr, nous « traduisons » ; mais, dès que nous cherchons à rendre la totalité du sens, que se soit pour « laïcité » ou pour « secularism », nous sommes obligés de passer par de longues périphrases, avec toujours le risque d’une perte de sens par rapport au mot d’origine. C’est l’une des raisons pour lesquelles les comparaisons de pays à pays sont aussi difficiles et pourquoi les incompréhensions réciproques aussi nombreuses.
Ce problème se rencontre dans toutes les langues, et c’est pourquoi on tend à privilégier une langue dans chaque pays. Le problème est particulièrement aigu dès que l’on rentre dans le vocabulaire juridique. L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) qui fixe dans ses articles 110 et 111 l’obligation d’utiliser le Français pour les actes d’administration et de justice[42], répondait à ce besoin de normalisation des formules afin de réduire la marge d’interprétation. Non que ces actes n’aient pas été écrits en Français, depuis le XIIIe siècle ; de fait, un nombre croissant l’était, au détriment du latin mais aussi des langues régionales. Mai il n’y avait pas obligation à le faire. En imposant cette obligation, l’ordonnance limite les risques d’interprétation. Il est en effet douteux que la coopération puisse se développer sans un langage commun entre les acteurs, et plus généralement des normes et croyances partagées. Il y a en Allemagne avec Martin Luther, un coup de force – tout aussi volontariste que celui des administrateurs royaux français – visant à constituer l’allemand en langue « noble », digne de porter une traduction de la Bible, et construite sur le modèle d’une langue ancienne (le Grec en ce cas d’espèce). Le langage contribue ainsi à la convergence des anticipations et à l’émergence de représentations communes à travers l’explicitation des points de vue dans des canaux reconnus jouant un rôle déterminant dans la constitution de ces représentations communes[43].
Mais, pourquoi devons-nous impérativement posséder un langage commun ? La réponse est claire : pour pouvoir agir en commun et surtout pour pouvoir penser un but commun par delà les différences de situation et de positions sociales. Et l’on comprend alors que cette notion de langage commun ne surgit avec force que parce que nous avons en tête non pas le « peuple en soi », simple réalité sociologique, mais le « peuple pour soi », communauté politique souveraine qui agit, prend des décisions et organise son destin. Il faut donc avoir en permanence à l’esprit cette distinction, héritée de Lukacs[44], entre le « peuple en soi » et le « peuple pour soi » pour comprendre pourquoi un langage commun devient impérativement nécessaire. Si l’on retire la souveraineté, si l’on retire cette faculté d’agir qui est l’essence même de la démocratie, alors le besoin d’un langage commun devient bien moins impérieux. C’est bien la souveraineté, et la démocratie, qui donnent à cette notion de « langage commun » toute son importance, et c’est bien parce que l’on fait le choix de défendre et la souveraineté et la démocratie que l’on accorde alors à ce qui constitue ce « langage commun » une importance particulière. De ce point de vue on ne peut distinguer des choix politiques donnés (pour la démocratie et la souveraineté) de la question de l’importance (ou de l’irrecevabilité) de la notion de « langage commun ».
- Laïcité et culture politique
Dans la culture politique française, soit dans l’ensemble des règles et des pratiques, des habitudes et des routines, qui représentent la coagulation de siècles d’histoire et de conflits, la laïcité occupe naturellement une place importante. Cette place découle à la fois du traumatisme collectif des guerres de religions que de la période d’intolérance religieuse induite par la révocation de l’édit de Nantes, des combats pour la séparation des églises et de l’Etat qui aboutirent à la loi de 1905, de la réaction aux périodes dites « d’ordre moral » (1872-1880 mais aussi le régime de fait de Vichy de 1940 à 1944), enfin de la lutte contre les micro-communautés, les seigneuries, du haut-Moyen âge. C’est avec le règne de Philippe le Bel (1285-1314) que l’on commence à voir s’autonomiser un appareil d’État, les « légistes royaux »[45], dont le champ des attributions dépasse largement celui de la propriété royale et c’est avec ce règne aussi que l’on voit apparaître les premiers arrêts écrits en français. C’est aussi sous son règne que le double mouvement de lutte contre les seigneuries locales (lutte commencée un siècle plus tôt) et contre un pouvoir à vocation internationale (celui du pape[46]) a pris toute son ampleur[47].
L’idée que le « peuple français » n’est pas une addition de communautés mais bien un ensemble de citoyens définis avant tout par l’égalité juridique en dehors de toute appartenance religieuse, ethnique ou sexuelle, est une idée dont les racines sont très profondes dans la société française. C’est cette idée qui sous-tend le principe politique de laïcité. Cette idée a trouvé une forme de manifestation en 1789, mais elle est en réalité antérieure, et elle fut portée à la fois par des intellectuels mais aussi par un mouvement populaire (on pense à Jeanne d’Arc) qui s’est exprimé de manière régulière dans l’histoire du pays.
Ajoutons à cela un rapport particulier aux questions religieuses (la France est le pays où il y a le plus grand nombre de personnes s’affichant comme athées), rapport qui n’est pas seulement le produit des querelles religieuses du passé et de leur mode de résolution, mais qui provient aussi de la trajectoire particulière de la « déchristianisation » de la société française. Cette déchristianisation résulte de ce qui devait être, à l’origine, une re-christianisation. Cette trajectoire est issue en réalité des réformes du concile de Trente (1563) et qui a commencé dès le début du XVIIIe siècle comme le montre, de manière particulièrement intéressante, André Burguière[48]. De ce Concile découle un enseignement : la mari doit protéger la femme, car le mariage est un sacrement. Or, la principale cause de mortalité féminine est l’accouchement. Les couples se mettent à pratiquer des méthodes contraceptives[49], que l’église catholique interdit. Il en résulte un conflit, qui pousse les populations à s’écarter de l’église[50], et qui met en mouvement ce que l’on appelle la « transition démographique »[51]. Mais, ce mouvement se conjugue avec un autre, qui touche les sphères plus intellectuelles de la société. Jean Bodin, à la fin du XVIe siècle, anticipe Spinoza qui écrira lui aussi que « la nature ne crée pas le peuple », autrement dit qu’il est vain de vouloir imaginer une origine « naturelle » à l’ordre social. Si l’ordre social ne procède pas de la loi divine comme de son origine ou de son fondement, la distinction entre le monde symbolique et le monde réel est désormais acquise. Spinoza dit que, moralement, il n’y a pas de problème si l’on a des points de vue religieux différents. On glisse d’une conception juridico-politique qui est celle de Bodin qui cherche à penser les conditions de fonctionnement de l’Etat, à une position philosophico-morale qui n’est d’ailleurs pas incompatible. Le point important, c’est que l’un et l’autre dynamitent l’ancien système et imposent une réforme décisive puisque seuls des critères politiques permettent de définir le peuple. On comprend pourquoi tous deux sont à l’origine de la laïcité et on comprend pourquoi la laïcité s’articule avec la souveraineté. Ces deux mouvements expliquent donc aussi les formes juridiques spécifiques d’incarnation du principe politique de laïcité dans notre culture politique, et pourquoi sa place est aussi centrale.
C’est l’une des raisons de la sensibilité très particulière de notre société à tout ce qui peut rappeler des segmentations communautaires, et ceci d’autant plus quand ces segmentations prennent l’apparence d’affirmations religieuses agressives (comme avec la burqa mais aussi sa variante balnéaire dite « burkini »). De plus, quand ces pratiques d’affirmations religieuses agressives se combinent avec une affirmation de misogynie institutionnelle, on comprend la virulence des réactions et leur côté massif, car il s’agit d’agressions qui touchent au plus profond de la culture politique de notre pays.
On dira, et ceci est exact, qu’il n’en est pas ainsi dans d’autres pays. Assurément ; et cela ne fait que vérifier la diversité nationale des cultures politiques. Mais pourquoi ce qui peut s’appliquer ailleurs s’appliquerait-il forcément en France et non l’inverse ? Car, il faudrait démontrer pourquoi l’étranger aurait systématiquement raison contre le citoyen français. Or, cette démonstration n’est jamais fournie, et pour une raison très simple, c’est qu’elle est impossible à fournir, tout comme il est aussi rigoureusement impossible d’étendre la culture politique de la France à d’autres pays. Si l’on accepte l’argument de la spécificité des cultures politiques (et non pas des principes politiques qui – eux – renvoient à des invariants pour des raisons fonctionnelles) alors cet argument vaut pour tous ou pour personne. Dès lors on comprend pourquoi certaines règles sont parfaitement légitimes dans un pays et non dans un autre. Ce qui pose bien entendu le problème de la subtantialisation de ces règles dans le contexte d’une certaine culture politique comme le montre Mathieu Bock-Côté[52].
Mais, la reconnaissance de la spécificité de TOUTE culture politique soulève alors le problème du passage d’une culture politique à une autre. Puisqu’il ne peut exister de langage universel (ce qui n’implique pas qu’il n’y ait des principes qui soient universels), comment, et à quelles conditions passe-t-on d’un langage à un autre ? Autrement dit, affirmer la spécificité irréductible d’une culture politique donnée vaut aussi pour l’ensemble de ces cultures et cela constitue immédiatement la question de l’intégration possible à cette culture en problème. On se souvient alors du vieil adage : « à Rome, fait comme les romains »[53]. On voit les implications de cet adage quant aux formes prises par le principe de laïcité.
- Intégration, assimilation et identité
Dire donc que chaque culture politique est spécifique, et que chaque culture politique constitue le « langage commun » que tout citoyen souhaitant participer comme citoyen au « peuple » se doit donc de posséder, pose donc la question de ce que l’on appelle l’intégration. L’intégration est un concept qui apparaît comme essentiellement politique. On s’intègre dans un corps politique particulier en en acceptant les règles organisatrices, explicites ou implicites. On participe aux débats collectifs qui se font dans le cadre de ces règles et de ces principes, et dont certains peuvent conduire d’ailleurs à modifier certaines des règles (une Constitution n’est pas immuable). Mais, pour ce faire, il faut s’approprier, c’est-à-dire il faut faire sien, un certains nombres de principes comme ceux d’égalité et de laïcité, parce que ces principes sont déterminant dans la constitution la plus large du corps politique. De ce point de vue tout citoyen qui prétendrait s’intégrer au corps politique français pour en subvertir les principes fondateurs, principes dont nous avons plus haut explicité l’origine fonctionnelle, devrait être tout d’abord réprimé voire refoulé hors de cet espace politique.
Le terme est, on peut le comprendre, violent. Mais ce « refoulement » n’implique nullement un refoulement territorial des individus. C’est en tant que citoyen que la personne serait refoulée, car n’acceptant pas les principes de base de la culture politique existante. D’ailleurs, des formes de répression et de refoulement existent dès aujourd’hui. Une personne ne peut tenir des propos racistes sans encourir amendes ou peines de prison, et si elle récidive de manière répétée, elle se voit en réalité interdite d’activité politique, voire d’activité professionnelle : un « chansonnier » l’a appris à ses dépens. La République se donne les moyens de réprimer, dans le cadre des lois et des règlements administratifs, ceux qui portent atteinte aux principes fondateurs de la République. On voit à travers ce point que le droit politique de participer à la vie de son pays a pour corollaire une obligation de responsabilité.
Cessons donc d’être faussement naïf. La liberté de chacun à un prix, et ce prix on accepte de le payer ou pas. Mais, si on s’y refuse, si l’on maintient des opinions publiques qui sont contradictoires avec les principes de base, on en subit les conséquences. De ce point de vue, rien n’est plus fausse que l’idée selon laquelle la démocratie serait un « open bar » où toutes les opinions pourraient être également défendues publiquement. Nous savons qu’en réalité ce n’est pas le cas et ce ne peut pas l’être. Dès lors, il convient d’en tirer les conséquences et d’être cohérent : toute position visant à diviser le corps politique en communautés séparées, remettant en cause le principe d’égalité juridique, parce qu’elle aboutit à paralyser le corps politique, le « peuple », appelle une réaction ferme de ce dernier. Rappelons, enfin que pour pouvoir « intégrer » il faut que le principe de séparation entre ceux qui font partie du corps politique et ceux qui n’en font pas partie soit respecté. Si ce principe s’efface, alors, l’intégration n’a plus de sens. Il faut donc préciser ce qui fait frontière dans le contexte du corps politique français. C’est le sens qu’il convient de donner au Préambule de la Constitution, repris du préambule de la Constitution de 1946, et écrit au sortir de la guerre contre le nazisme[54].
Ce qui distingue alors la question de l’intégration de celle de l’assimilation apparaît alors nettement. On assimile (individuellement) des coutumes, des habitudes, des comportements et l’on s’assimile, de manière toujours imparfaite et toujours incomplète, ce qui est une bonne chose car une homogénéité totale n’est ni souhaitable ni possible, à la culture du pays dans lequel on vit. Ces deux mouvements sont nécessaires et ne se recoupent pas. L’assimilation des coutumes et des habitudes se fait d’habitude par l’école, par l’apprentissage de la langue et de l’histoire d’un pays. Mais, pour qu’elle puisse se produire, encore faut-il que le « peuple » ait la conscience d’exister (la souveraineté que permet la constitution du peuple « pour soi ») et qu’il offre aux nouveaux arrivant le cadre, tant en matière d’emploi que d’éducation qui permettra à cette assimilation de ce faire. Ici, il faut reconnaître la profonde déficience des institutions et du personnel de la République qui depuis environ 20 ans, voire plus, a abandonné ces terrains, s’est accoutumé à l’idée d’un chômage de masse, à l’abandon de l’enseignement de notre langue et de notre histoire. Le processus réflexif qui consiste donc à s’assimiler (et non seulement à assimiler l’ensemble des réflexes et comportements qui permettent de vivre ensemble), relève d’un choix individuel qui doit être laissé à la discrétion de chacun. On n’est pas moins français parce que l’on parle, en plus du français naturellement, le breton, le provençal, le basque l’alsacien ou le corse, ou encore l’italien, l’espagnol, l’arabe, le chinois, le portugais ou le hongrois, le yddish ou le russe…Cette décision, qu’elle soit consciente ou inconsciente, doit être laissée à la liberté de chacun.
L’identité de chaque individu est un camaïeu d’identités partielles qui se combinent et s’entrecroisent au gré de l’histoire individuelle. Certaines de ses identités sont douloureuses, parce qu’elles gardent les traces historiques de drames divers. Mais, l’identité politique est une, et elle est fondée sur l’acceptation de la culture politique qui constitue alors ce « langage commun » dont nous avons besoin pour agir ensemble. Pour ne pas avoir compris la distinction nécessaire entre des identités multiforme et la nécessaire unité de l’identité politique, les dirigeants politiques de la droite française, qu’il s’agisse de Nicolas Sarkozy ou d’Alain Juppé, entraînent le débat dans une impasse. Mais, pour refuser cette notion même d’identité politique et par la fétichisation des identités culturelles, une grande partie de la « gauche », ou de ce qui se croit telle, conduit le pays à la guerre civile. Il convient, ici, de citer Jacques Julliard : « … la République à son tour est devenue suspecte. N’a-t-elle pas une connotation presque identitaire, «souchienne» disent les plus exaltés, pour ne pas dire raciste? N’est-elle pas le dernier rempart de l’universalisme occidental contre l’affirmation bruyante de toutes les minorités? N’est-elle pas fondée sur ce qui rapproche les hommes plutôt que sur ce qui les distingue? Un crime majeur aux yeux des communautaristes »[55].
- Interculturalisme, multiculturalisme et souveraineté
La véritable question est donc de savoir s’il y a une culture française, avec ce que cela implique comme comportements communs au-delà du maintien chez ceux qui le souhaitent de racines culturelles diverses, ce que l’on peut appeler une interculturalité. En particulier il convient de prendre position par rapport au projet multiculturaliste, dont une partie de la « gauche » fait aujourd’hui l’alpha et l’oméga de sa réflexion politique.
On voit bien que se développe aujourd’hui un projet multiculturaliste[56], que Mathieu Bock-Côté qualifie de religion politique. Ce projet dissocie le « peuple » et le scinde en une succession de communautés, réduisant alors chaque individu à l’une de ses caractéristiques, catholique, protestant, juif ou musulman, ou encore homme ou femme, puis viendront jeunes et vieux ; ce processus n’a pas de fin. Il interdit, de fait la constitution d’un espace politique (et bientôt juridique, comme on le voit en Grande-Bretagne avec l’existence de tribunaux religieux) unifié, ce qui est pourtant la condition sine qua non pour que les autres caractéristiques des individus, qu’elles soient sociales ou qu’elles soient politiques, puissent librement se confronter. Cette disparition du « peuple » a pour conséquence bien entendu celle de la souveraineté, puisqu’il n’y a plus de « souverain ». Cédons sur ce point et nous cédons sur tout. Or la pente est ici rapide qui consiste à présenter des « coutumes » comme faisant partie d’une identité « culturelle » pour les mettre hors de tout débat. Très clairement, ceux qui se comportent ainsi se rendent coupables de complicité avec des crimes (comme dans le cas de l’excision par exemple) et s’avèrent les pires ennemis aujourd’hui de la démocratie et de la République.
À l’inverse, le fait de reconnaître une inter-culturalité, mais dans le cadre d’une intégration à une culture politique structurée par quelques principes de base, permet l’émergence d’une collectivité de projet et d’action. Que certains projets soient contradictoires, qu’ils puissent s’affronter – et parfois violemment – est alors l’une des caractéristique de la démocratie qui est tout sauf apaisée. Des conflits qui en résultent découlent des conflits et des compromis, qui eux-mêmes construisent le cadre des institutions permettant à de nouveaux projets de s’affronter dans des espaces politiques toujours plus construits et dont la souveraineté est toujours mieux affirmée.
Ce qui est donc aujourd’hui l’enjeu de ce combat pour la laïcité dans sa dimension culturelle dépasse, et de loin, l’interprétation restrictive de cette laïcité réduite à la simple séparation des églises et de l’Etat. La dimension culturelle de la laïcité est considérable. Or, c’est toujours sur les questions culturelles que se jouent les débats les plus importants[57].
Notes
[1] http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1552646-arretes-anti-burkini-femmes-voilees-verbalisees-la-laicite-ultime-refuge-du-raciste.html
[2] http://www.journaldemontreal.com/2016/08/22/burkini–le-monde-a-lenvers
[3] http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/08/26/31001-20160826ARTFIG00315-jacques-julliardqu-est-ce-que-l-islamo-gauchisme.php
[4] Voir Nicollet C., « Polybe et la ‘constitution’ de Rome » in C. Nicollet (dir), Demokratia et Aritokratia. A propos de Caius Gracchus : mots grecs et réalités romaines, Paris, Presse de la Sorbonne, 1983.
[5] Bretone M., Histoire du droit romain, Paris, Delga, 2016, p. 216.
[6] Idem, p. 215.
[7] Frezza P., Corso di storia del diritto romano, Rome, Laterza, p. 440.
[8] Brunt P.A., « Princeps et Equites », in The Journal of Roman Studies, vol 73, 1983, pp. 42-75.
[9] Schmitt C., Théologie Politique, traduction française de J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988; édition originelle en allemand 1922, pp. 8-10
[10] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Paris, Michalon éditeur, 2016.
[11] « Le sexe et la religion font partie de la vie privée ».
[12] Voir l’article cité, [12] http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/08/26/31001-20160826ARTFIG00315-jacques-julliardqu-est-ce-que-l-islamo-gauchisme.php
[13] Locke, J., Essai sur la Tolérance, Paris, Éditions ressources, 1980 (1667)
[14] Burkert W., « Cicero als Platoniker and Skeptiker. Zum Platonverstännis der Neue Akademie » in Gymnasium, vol. 72 (1965), p. 175-200.
[15] Talbert R.J.A., The Senate of Imperial Rome, Princeton, Princeton University Press, New Jersey, 1984, pp. 488-491.
[16] Bodin J, Les six livres de la République, Réimpression, Scientia Aulem, Amsterdam, 1961.
[17] Durkheim E., Les règles de la méthode sociologique,PUF, coll. Quadriges, Paris, 1999 (première édition, Paris, 1937), pp. 112-115.
[18] Sapir J., Les économistes contre la démocratie, Paris, Albin Michel, 2002 et Idem, Souveraineté, Démocratie, Laïcité, op.cit..
[19] Sapir J., Quelle économie pour le XXIè siècle?, Odile Jacob, Paris, 2005
[20] H.A. Simon, « Rationality as a process and as a Product of thought » in American Economic Review, vol. 68, 1978, n°2, pp. 1-16.
[21] A. Tversky, « Rational Theory and Constructive Choice », in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C. Schmidt (edits), The Rational Foundations of Economic Behaviour, Macmillan et St. Martin’s Press, Basingstoke – New York, 1996, pp. 185-197. Pour une discussion plus générale des conséquences de ce résultat, J. Sapir, « Théorie de la régulation, conventions, institutions et approches hétérodoxes de l’interdépendance des niveaux de décision », in FORUM A. Vinokur (ed.), Décisions économiques , Économica, Paris, 1998, pp. 169-215.
[22] Voir C.R. Sunstein, « Constitutions and Democracies: an epilogue », in J. Elster & R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993 (1988), pp. 327-356.
[23] T. Jefferson, « Notes on the State of Virginia », inWritngs – edited by M. Peterson, Library of America, New York, 1984. J. Locke, Two Treatise of Governments, Mentor, New York, 1965, Livre II, ch. 8.
[24] S. Holmes, « Gag rules or the politics of omission », n J. Elster & R. Slagstad, (eds.), Constitutionalism and Democracy, pp. 19-58.
[25] S. Holmes, « Gag-Rules or the politics of omission », op.cit., p. 58.
[26] F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty – Vol. I, Rules and Order, op.cit., pp. 131 et ssq.
[27] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932
[28] Idem, p. 40.
[29] R. Bellamy (1999), Liberalism and Pluralism: Towards a Politics of Compromise, Londres, Routledge,
[30] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991.
[31] Dyzenhaus D., The Constitution of Law. Legality In a Time of Emergency, Cambridge University Press, Londres-New York, 2006, p. 22.
[32] Cartier E., La transition constitutionnelle en France (1940-1945). La reconstruction « révolutionnaire » d’un ordre juridique « républicain », LGDJ, col. Droit public, Paris, 2005, 665 p.
[33] Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental. Version consolidée au 10 août 1944 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071212
[34] Conan E. et H. Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas, éd. Fayard, Paris, 1994 ; nouvelle édition Gallimard, coll. « Folio histoire », Paris, 1996, 513 p, p. 71.
[35] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071212
[36] Ce qui se dit aussi, dans une forme plus juridique : « Dans un besoin ou un péril extrême, on peut se soustraire à toutes les obligations conventionnelles ». Voir Cassella S., La Nécessité en Droit International: De L’état de Nécessité Aux Situations de Nécesité, Martinus Nijhoff Publishers, 2011 – 577 p., p. 5 et 6.
[37] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749
[38] http://www.lepoint.fr/societe/deux-francais-sur-trois-opposes-au-burkini-25-08-2016-2063657_23.php
[39] Saint Augustin, La Cité de Dieu, Trad. G. Combés, revue et corrigée par G. Madec, Paris, Institut d’études augustiniennes, 1993,
[40] http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/04/29/31001-20160429ARTFIG00349-mathieu-bock-cote-l-homme-sans-civilisation-est-nu-et-condamne-au-desespoir.php
[41] Bock-Côté M., Le multiculturalisme comme religion politique, Paris, le Cerf, 2016
[42] Soleil S., « L’ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France », in Le Pourhiet A-M, (Dir), Langue(s) et Constitution(s), Presses Universitaires d’Aix, Marseille, Economica, 2003 ; pp. 19-34.
[43] Voir l’argumentation de C. Gruson, “L’organisation d’un monde intelligible”, in G.Markhoff, (ed;), Vers une éthique politique, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1987.
[44] de Lukacs G., Histoire et conscience de classe. Essais de dialectique marxiste. Paris, Les Éditions de Minuit, 1960, 383 pages. Collection « Arguments »
[45] Favier J., Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel », in Journal des savants, no 2, 1969, p. 92-108. Idem, Un Conseiller de Philippe le Bel : Enguerran de Marigny, Paris, Presses universitaires de France, (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes), 1963.
[46] C’est le fameux « incident d’Anagni ».
[47] Voir Carré de Malberg R., Contribution à la Théorie Générale de l’État, Éditions du CNRS, Paris, 1962 (première édition, Paris, 1920-1922), 2 volumes. T. 1, pp. 75-76.
[48] A. Burguière, « Le changement social: histoire d’un concept », in Lepetit B., (ed.), Les Formes de l’Expérience. Une autre histoire sociale, Albin Michel, Paris, 1995, pp. 253-272.
[49] Chainaux A. et Dauphin C, « La contraception avant la Révolution française, l’exemple de Châtillon-sur-Seine », in Annales ESC, n°3, 1969, pp. 662-684.
[50] Bergues H. (et alii), La Prévention des naissances dans la famille, Paris, PUF-INED, 1960.
[51] Weir D., Fertility Transition in Rural France, 1740 – 1829, Ph.D., Departement of Economics, Université de Stanford, Ca, 1982.
[52] http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/08/09/31003-20160809ARTFIG00129-ce-que-revele-l-affaire-du-burkini.php
[53] Ambroise de Milan : si fueris Romae, Romano vivito more; si fueris alibi, vivito sicut ibi
[54] Le texte est le suivant : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
[55] http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/08/26/31001-20160826ARTFIG00315-jacques-julliardqu-est-ce-que-l-islamo-gauchisme.php
[56] http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/04/29/31001-20160429ARTFIG00349-mathieu-bock-cote-l-homme-sans-civilisation-est-nu-et-condamne-au-desespoir.php
[57] Brustier G., A demain Gramsci, Paris, Le Cerf , 2015.
Source: russeurope.hypotheses.org
