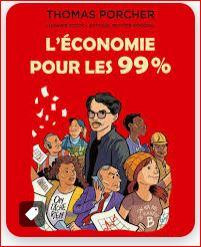Astrid di Crollalanza
Dans sa première bande dessinée scénarisée par Raphaël Ruffier-Fossoul et illustrée par Ludivine Stock, « L'économie pour les 99 % » (Stock), Thomas Porcher vulgarise avec brio sa discipline, tout en proposant un modèle alternatif.
À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ? demandait il y a quelques années un livre dirigé par l'économiste atterré André Orléan. Presque une décennie plus tard, rien n'a changé : sur les plateaux télévisés comme dans les grandes radios, on entend à longueur de journée les mêmes défenses de la dérégulation, du libre-échange et de l'austérité. Pourtant, il n'existe pas d'unanimité sur tous ces sujets.
Économiste atterré également, Thomas Porcher fait partie voix dissonantes. Hétérodoxe et pédagogue, il publie L'économie pour les 99 % (Stock). La bande dessinée a pour point de départ une visite dans une raffinerie et sa rencontre avec une jeune fille. L'auteur explique de manière ludique qu'un autre système économique, favorable aux travailleurs comme aux retraités et aux agriculteurs, et respectueuse de l'environnement, est possible et même nécessaire. Marianne l'a rencontré.
Marianne : L’accord entre l’UE et le Mercosur provoque certaines craintes, notamment dans le monde agricole. Qu’en pensez-vous ?
Thomas Porcher : Je pense que dans tous les secteurs, nous avons été trop loin dans le libre-échange. Dans ma BD, plusieurs pages expliquent comment les agriculteurs sont enfermés dans une crise systémique. Au départ, l’ouverture au marché leur a profité. Puis il y a eu un « effet boomerang », avec la concurrence des pays émergents.
Ce sera pareil avec l’accord avec le Mercosur. On nous avait promis des taux de croissance de dingue avec le marché unique, que nous n’avons jamais connu. Là, beaucoup d’éditorialistes nous refont le même coup. Il y a de fortes chances qu’il y ait au départ des effets positifs. Mais ensuite, les multinationales utiliseront les législations, profiteront des pays où les normes environnementales et sociales sont plus faibles.
À LIRE AUSSI : Agriculture : comment l'accord UE Mercosur risque de plomber les paysans français
Ces dernières années, notamment avec la crise du Covid, nous avons remis sur la table de vraies questions : l’industrialisation, la souveraineté et la lutte contre le réchauffement climatique. Le Mercosur n’est une réponse à aucune de ces questions.
Pourtant, depuis David Ricardo (1772-1823), un consensus se détache chez les économistes mainstream, ceux qui dominent la recherche et obtiennent la majorité des prix Nobel, en faveur du libre-échange…
Avec le libre-échange, il y a des gagnants et des perdants. Les multinationales sont clairement les gagnantes. Lorsque vous ouvrez des marchés, cela crée de la concurrence qui finit souvent par une baisse des réglementations. Et, au bout du compte, les multinationales peuvent établir leur stratégie en produisant là où ce n'est pas cher, vendre là où il y a des salaires élevés et payer des impôts là où la fiscalité est faible.
Aujourd’hui, un certain nombre de commentateurs oublient qu’une grosse partie des échanges s’effectue entre filiales d'une même multinationale. C’est quasiment 40 % des échanges. Je ne vois pas en quoi faciliter encore plus le libre-échange avec ces traités pourrait profiter à qui que ce soit, si ce n’est encore aux multinationales. Ce serait un choc de concurrence pour les agriculteurs mais aussi pour certaines industries qui subissent déjà la concurrence venant de l'Est et même des États-Unis.
Néanmoins, les choses ont évolué. Des économistes comme Joseph Stiglitz, prix Nobel en 2001, ont critiqué l’organisation du commerce international. Le mot « protectionnisme », qui était, il y a encore peu, un gros mot, est maintenant présent, y compris dans le vocabulaire des libéraux comme Macron. D’autres termes comme « réindustrialisation », « souveraineté » ou « planification » sont revenus. Mais si le vocabulaire est là, les dirigeants peinent à passer aux actes.
Selon vous, le triptyque « mondialisation-financiarisation-austérité » a échoué. Pourquoi ?
Il a profité à une petite partie de la population, mais pas aux 99 %. Vous avez actuellement des entreprises comme Michelin qui font des résultats nets de 2 milliards, mais qui, en même temps, suppriment 1 200 emplois. Aucune théorie économique n'avait prévu cela. Même chez les libéraux, les bénéfices doivent être réinvestis. Là des emplois sont supprimés alors qu’il y a des bénéfices.
À LIRE AUSSI : Thomas Porcher : "Le sort des cadres est plus proche de celui des classes populaires que d’une élite mondialisée"
Avec la mondialisation, les 1 % ont pu délocaliser des usines. Avec la financiarisation, ils ont gagné énormément d'argent. Il suffit de regarder les rémunérations des grands patrons et des actionnaires, qui ont explosé ces trente dernières années. Et en même temps, il y a eu moins de rentrées fiscales, donc de l'austérité budgétaire, qui a pâti aux 99 %.
En quoi cela a-t-il creusé l’endettement ?
L'endettement est un épouvantail qu'on agite pour faire de l’austérité. Chaque fois qu'il y a des coupes dans les services publics, cela profite au secteur privé. Dans tous les pays où vous avez une dépense publique faible, vous avez une dépense privée très élevée. Le secteur privé en profite d’autant plus que face à la concurrence internationale, nous avons très fortement baissé la fiscalité sur les grandes entreprises. Beaucoup de grandes entreprises arrivent à échapper, en grande partie, à l'impôt via des mécanismes d'optimisation fiscale.
Prenez par exemple le CAC 40 en France : il y a 1 200 filiales dans les paradis fiscaux. Si les entreprises y vendent des choses qu'elles produisent, pourquoi pas ? Mais si elles ne produisent pas et n'ont pas d'outils de production là-bas, c'est qu’elles y sont pour d’autres raisons. Il faudrait s'interroger là-dessus. Donc la mondialisation a baissé, via la concurrence, les niveaux de fiscalité. Mais elle permet aussi, via des mécanismes fiscaux, d'éviter de payer l'impôt et donc, en partie, de plomber les comptes.
Et en quoi l’endettement n’est-il pas un problème ?
L'endettement n'est pas un problème parce que les investisseurs veulent encore acheter notre dette. C'est ça, le paradoxe. Je ne dis pas qu'il faut continuer comme cela ad vitam aeternam, mais en fait, ces dix dernières années, nous avons utilisé la dette pour pratiquer de l'austérité dans les services publics, tout en baissant très fortement les impôts. Il y a eu 70 milliards de baisses d'impôts, dont 40 milliards sur les entreprises.
Mais de l'autre côté, cela oblige à couper dans la dépense publique. Et ces dix dernières années, il y a des investissements qui n'ont pas été faits, par exemple à l'hôpital. Un an avant la crise, une aide-soignante du CHU de Rouen a interpellé Emmanuel Macron en lui disant que le système de santé avait besoin de moyens. Il lui répond : « Il n'y a pas d'argent magique. » Il lui dit que la priorité est de réduire la dette et le déficit. Un an après, il explique qu’il va réaliser un plan massif d'investissements pour l'hôpital public.
À LIRE AUSSI : Thomas Porcher : "Les carburants sont le thermomètre de la grogne sociale"
La dette a souvent servi pour ne pas faire les investissements nécessaires en temps et en heure. Pourtant aujourd'hui, notre dette est soutenable. Pourquoi ? D’abord parce que les taux d'intérêt, même s'ils augmentent, sont plus faibles qu'il y a six mois.
Deuxièmement, parce qu'il y a deux fois plus d'investisseurs qui veulent acheter notre dette qu'on émet d'obligations. Cela signifie que les investisseurs demandent encore notre dette. Ce qu'il faut, c'est être crédible, proposer un plan de réduction du déficit sur cinq ans ou un peu plus longtemps et ne pas faire des coupes sévères comme nous le faisons.
Nous allons couper 60 milliards, soit 2 % du PIB, ce qui équivaut au premier plan d'austérité de la Grèce, qui a eu un impact négatif sur la production et in fine fait augmenter la dette.
Vous défendez le modèle keynésien. Pouvez-vous en donner les contours ?
En fait, ce que nous percevons actuellement dans les carnets de commandes des entreprises, c’est que nous n’avons plus un problème d'offre, mais un problème de demande. Il faut donc relancer la demande, en augmentant les salaires. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n’arrivent pas à vivre avec le salaire minimum. Et il faut également faire des investissements publics massifs, parce que plein de secteurs ont besoin d'investissements publics : l'éducation, la petite enfance, les maisons de retraite, mais aussi la rénovation des bâtiments, les voitures électriques, l'innovation.
Tous les pays le font, à commencer par les États-Unis, et Trump poursuivra. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les débats entre Donald Trump et Kamala Harris abordaient très peu la question de la dette, alors que la leur est supérieure à la nôtre et leur déficit également. Les Chinois ont augmenté de plus de 100 milliards leur déficit pour financer leur plan de relance. Donc, des deux côtés, les concurrents de l'Europe font des plans de relance. Nous nous enfermons dans des questions de déficit ou de dette, alors que nous devrions faire l’inverse. Nous sommes en train de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2010.
Mais si ce modèle a été abandonné, c’est parce qu’il a failli : dans les années 1970, lors de la stagflation (mélange de stagnation et d’inflation) qui a suivi les chocs pétroliers, et au début des années 1980, avec le plan de relance de Mitterrand.
Je ne suis pas d'accord. Il ne fallait pas faire de la relance pour faire de la relance, parce que dans ce cas, nous risquons de redonner de l'argent à plein d'entreprises qui vont continuer à délocaliser et à pratiquer de l'optimisation fiscale. Pour que la relance marche, il faut un stratège à la tête de l’État. Il faut bien choisir les secteurs.
À LIRE AUSSI : Chômage, faillites, pouvoir d'achat… Pourquoi l'économie française replonge
Dans l'état actuel des choses, si vous relancez en période de mondialisation, l'argent ira tout droit dans la poche des actionnaires. C'est ce qu’il s'est passé avec le CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) : une grosse partie a été captée par les actionnaires. C'est également ce qu’il s'est passé avec la baisse de l'ISF (impôt de solidarité sur la fortune). C'est normalement le but du commissariat au Plan de choisir les secteurs et d’expliquer comment une relance peut être efficace. Et quand on lit leurs rapports, aucune solution n’est proposée.
Après 1981, effectivement, Mitterrand a vite changé d'avis. Au départ, c'était un petit peu bricolé, mais il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. D'ailleurs, un article de Liêm Hoang-Ngoc dans Marianne explique qu'il y avait des réussites sur certains points. Mais les socialistes ont paniqué dès qu'ils ont eu un peu d'inflation. Ils auraient peut-être pu continuer.
Mais pour que ce modèle existe, est-ce qu'il ne faut pas, au préalable, rompre le libre-échange et retrouver un peu de souveraineté sur la monnaie ?
Ce serait mieux. L'euro a été mal ficelé. À cause de lui, aujourd'hui, il y a de la concurrence sur le social, sur le fiscal, parce qu’il n’y a plus la possibilité de dévaluer. Mais sortir de l'euro, c’est autre chose. Même si techniquement cela a été théorisé par plein de gens, dans les faits, je pense que l’impact serait trop brutal, dans une situation où les gens comme l'économie sont très fragiles. Je ne sais pas si quelqu'un serait prêt à le vivre. Donc il faut faire avec.
Il y a deux solutions. Soit on part du cadre européen et on tente de réformer l'Europe. C'est un peu le serpent de mer dont on parle depuis Yanis Varoufakis, Podemos, etc. Soit on se dit qu’on reprend une partie des leviers, notamment la politique budgétaire à l'échelle nationale, en taxant par exemple les plus riches, etc. Au niveau national, nous avons quand même des marges de manœuvre.
En quoi s’agit-il d’une « économie pour les 99 % » ?
Déjà, parce que c'est une économie qui renforcerait les services publics. Et vous savez ce qu'on dit ? Les services publics, c’est le patrimoine du pauvre. L'éducation, la petite enfance, l'hôpital, cela touche beaucoup de monde, notamment avec une population qui vieillit : 80 % des dépenses de santé se font après soixante ans et nous sommes en train de faire encore des économies sur l'hôpital et nous voulons en faire sur les retraites. C’est une économie dans laquelle le modèle social serait préservé et les services publics seraient relancés.
À LIRE AUSSI : "Il est temps de remettre l'économie à sa place : au service des besoins sociaux et des écosystèmes"
Enfin, il y a la question du meilleur partage de la richesse créée, que ce soit avant la taxation ou après. Actuellement, dans la distribution des revenus primaires, il y a des différentiels que j'estime trop grands. Il faudrait réduire l’écart entre revenu primaire et préserver nos mécanismes de redistribution. Tout cela profiterait à la majorité de la population. Cela ne signifierait pas que les 1 % s’appauvriront. Lorsque nous regardons les années 1950 à 1970, les 1 % s'enrichissaient toujours, mais moins vite que le reste de la population. Depuis, ils s'enrichissent plus vite. C'est cela qui n'est pas normal.
Le keynésianisme a été un modèle qui a sauvé le capitalisme, en le régulant. Ne faut-il pas peut-être sortir de ce mode de production ?
L’anticapitalisme, c’est intéressant théoriquement parlant, dans les débats, dans des échanges intellectuels. Mais concrètement, je constate autour de moi que la plupart des gens veulent juste avoir un peu plus de revenus, pour pouvoir avoir un peu plus de loisirs et partir en vacances, avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs transports publics.
À LIRE AUSSI : Anticapitalisme : à la recherche d'un "Marx vert"
Pourquoi ne pas réfléchir à l’après-capitalisme d'un point de vue théorique, mais dans les faits, il y a des urgences plus prégnantes. L’anticapitalisme, c'est devenu une posture qui est très à la mode alors qu’elle avait disparu.
Jusqu'à la crise financière…
Oui, avec la crise et l’austérité, c'est revenu. Mais beaucoup de ceux qui se disent anticapitalistes mènent souvent une vie assez capitaliste. Je préfère pour ma part dire que je suis contre le « capitalisme libéral » qu’anticapitaliste.