Entretien avec Juliette Volcler
Chercheuse indépendante et atypique, Juliette Volcler est une voix qui compte dans le monde sonore et radiophonique. Le son comme arme et Contrôle, ses deux ouvrages parus à La Découverte, invitent à repenser notre rapport au son et à développer une écoute plus critique. Juliette nous raconte son engagement dans les radios libres, ses conditions et ses méthodes de recherche, son goût pour les “sources grises”, son aversion pour le jargon, et l’aventure de Syntone, revue dont elle fut la coordinatrice éditoriale pendant 7 ans. Elle évoque aussi ses recherches actuelles autour du “nudge” et du design sonore, qui sera l’objet de son prochain ouvrage.
- Avant d'écrire sur le son, pour la revue Syntone et pour les ouvrages publiés aux éditions de La Découverte, tu as aussi eu une pratique radiophonique en tant que productrice de l'émission l'Intempestive sur Fréquence Paris Plurielle et Radio Galère. Peux-tu nous parler de cette période ?
C'est par la radio associative que je suis tombée dans le son, en fait. Ça a profondément marqué ma manière d'envisager le son, qui depuis ce temps reste pour moi indissociablement lié aux luttes sociales. J’ai commencé par les radios libres, je suis arrivée à Fréquence Paris Plurielle en 2005. J'y ai d'abord participé à une émission collective qui s'appelait Les oreilles loin du front, une émission de sociologie. J’ai fait mes premières armes là, c'était vraiment chouette. J’y ai découvert le côté pluridisciplinaire de la radio que je trouve génial : on pouvait faire de l'entretien en studio, ou des prises de son dans la rue, s'occuper de la régie... J'étais curieuse de découvrir différents postes et de m'initier à la technique, j’ai donc vraiment été d’un côté et de l'autre de la vitre du studio. J’en garde un très bon souvenir. Au bout d'un certain temps j'ai eu envie d'avoir ma propre émission pour expérimenter le documentaire. Pour avoir la liberté de partir dans plein de directions sans que ça n'engage tout un collectif, il était préférable que je me lance toute seule. J’ai donc produit l’émission mensuelle L’Intempestive à partir de 2007. Le premier documentaire que j’ai fait dans ce cadre-là c’était sur le village d’Orgosolo en Sardaigne où il y a plein de peintures murales politiques. J’avais une amie universitaire spécialiste de ce champ-là, et qui faisait son “terrain” dans ce village. Sa démarche de chercheuse était assez singulière, puisqu’elle avait décidé d'emmener avec elle plusieurs potes qui avaient des pratiques très différentes. Il y avait une photographe, un artiste qui faisait lui-même des peintures murales engagées, et moi, qui étais là pour faire du son. Et bien sûr mon amie chercheuse en ethnographie et sociologie.

L'une des fresques qui ornent les murs du village d'Orgosolo. Crédits photo : Hélène Degrandpré.
On est resté.es un mois et demi. Le truc vraiment drôle c’est que je suis arrivée là-bas avec mon micro, sans avoir jamais fait de docu, et qu'en allumant mon enregistreur pour la première interview sur la place du village, je me suis dit “Merde, mais en fait je ne parle pas sarde et même pas italien !”. Je n’avais juste pas pensé à cet aspect-là ! C’était des débuts dans le docu totalement burlesques. Les gens du coin m’ont regardée de manière ironique. Mais finalement ça ne m’a pas dérangée plus que ça, parce qu’assez vite des liens amicaux se tissaient avec d’autres personnes capables de jouer les interprètes ou les intermédiaires pour moi : notamment un vieux berger communiste qui nous avait pris sous son aile. Il y avait aussi un collectif de femmes qui parlaient français.
Ce tournage a été ma première découverte de l'écoute, du temps d'écoute qu’il faut consacrer simplement pour appréhender un territoire. Le documentaire s’appelle Orgosolo où les murs parlent et les hommes chantent parce qu’il y aussi une pratique très forte du chant polyphonique dans ce village. Par la suite, sur FPP puis Radio Galère, j’ai continué des aller-retours entre des émissions de critique sociale, des formes plus axées sur l’entretien, et des formes plus produites de type documentaires. Avec aussi des collaborations régulières au sein d’émissions collectives. Je me suis aussi mise à militer beaucoup pour les radios libres. C’est à cette époque que j’ai rencontré des amis comme Benoît Bories qui était alors sur Canal Sud à Toulouse, ou Olivier Minot sur Radio Canut à Lyon : on a tissé pas mal de liens entre producteurs-trices indépendants, attachés aux radios libres et à la liberté qu’elles permettaient. Je reviens depuis peu à la production. J’ai interrompu L’Intempestive en 2013, et depuis le confinement j’ai créé avec une amie compositrice, Aude Rabillon, une émission qui s’appelle Radio renversée.
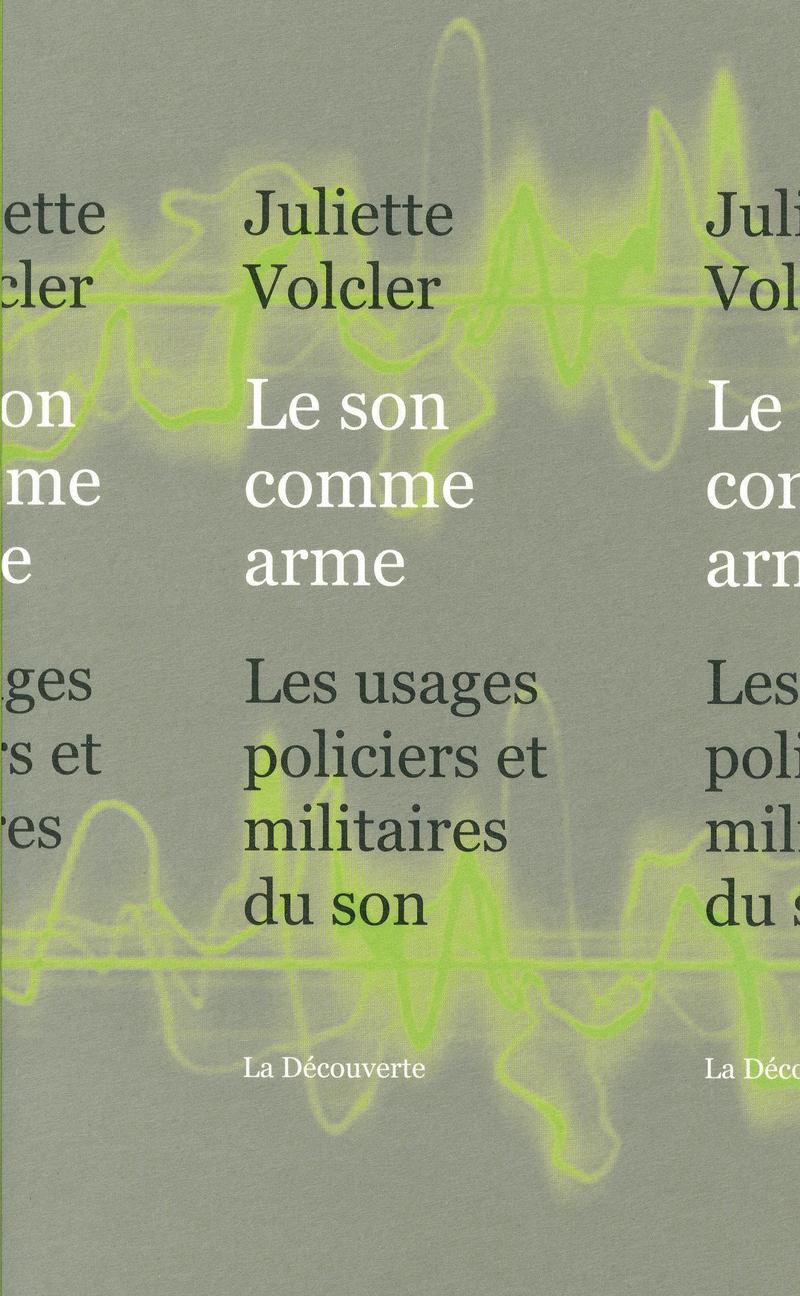
- En 2011 tu as publié Le son comme arme aux éditions La Découverte. Peux-tu nous expliquer comment est née l'idée de ce projet et de quoi il traite ?
Le projet du Son comme arme est né pendant que j’étais à FPP. Vers 2007 j'ai commencé à m'intéresser à la question du son de manière plus spécifique, en fait. À la fois “comment fonctionne une radio”, mais aussi “qu'est-ce que le son dans le champ social”. À cette époque, j'ai rencontré les gens d’Article 11, des copains qui faisaient un site indépendant devenu un journal pendant quelques années. Ils faisaient de la critique sociale et de la critique littéraire en même temps : j'aime beaucoup quand ces choses-là s’entremêlent. Je pense que les formes de résistance ou d'invention passent toujours par les questions sociales et artistiques à la fois. Un format doit être radical dans la forme comme dans le contenu. S'il n’y a que l'un ou que l'autre, ça ne me semble pas abouti. À l’époque, j'ai commencé à voir passer des articles sur l'usage du Mosquito, un répulsif sonore qui visait les jeunes, des fréquences très aiguës diffusées pour les faire fuir. Et puis d’autres articles sur l'usage de la musique comme moyen de torture à Guantanamo ou bien dans les prisons secrètes de la CIA. Au même moment les États-Unis commençaient à employer dans les manifs ce que les médias nommaient un “canon à son”, un haut-parleur très directionnel et extrêmement puissant conçu pour blesser l’oreille : le LRAD. Le Mosquito et le LRAD sont apparus au début des années 2000. L’usage de la musique comme moyen de torture est lui bien antérieur. Du coup ça m'a intéressé de comprendre d'où ça venait. Pourquoi il y avait cette émergence-là d’un usage répressif du son. Je voulais comprendre quel effet réel produisait ces armes sonores : on lisait dans la presse des trucs qui paraissaient un petit peu science-fictionesques.
“Paradoxalement, le silence est sans doute l’usage le plus violent qu’on puisse faire du son”
J'avais proposé à plusieurs journaux de faire une grosse enquête là-dessus et c’est Article 11 qui avait accepté : ça a été le début d'un compagnonnage assez long avec eux. J'ai publié 4 articles très longs sur les usages du son par la police et par les militaires. C'était très axé sur l'actualité. Et puis suite à ça il y a un éditeur à La Découverte, Rémy Toulouse, qui connaissait Article 11 et qui m’a dit que ce serait bien d’en faire un bouquin. J’ai passé les dix mois suivants à l’écrire. C’était une période très enthousiasmante intellectuellement : tout le premier chapitre du livre explique les fonctionnements de base du son, et moi-même j’ai dû me former et lire beaucoup pour écrire cette partie. Le livre porte sur les usages répressifs et coercitifs du son. J’ai structuré le livre en fonction des gammes de fréquences, essentiellement parce que ça m’amusait de l’écrire comme ça : des sons graves jusqu’aux plus aigus en passant par le silence qui est essentiellement le silence des sons médiums. La partie sur le silence est donc au centre du livre, aussi parce que le silence imposé à un individu est sans doute l’usage le plus violent qu’on puisse faire du son, paradoxalement.
Je me suis attachée à décrire historiquement tous les efforts qui avaient été faits pour rendre le son violent, à démontrer que ça ne sortait pas de nulle part, que ce n'était pas une invention magique des années 2000, et que ça s’ancrait dans des programmes de recherche qui remontaient bien en amont . Ce qui est intéressant, c’est que la majorité de ces expérimentations ont échoué, et malgré l’échec, certaines sont restées aujourd'hui dans l'imaginaire comme des fantasmes autour du pouvoir maléfique du son. Les fabricants en jouent beaucoup au niveau publicitaire notamment. Dans l'imaginaire au sens plus large, on retrouve ces fantasmes à la fois dans des ouvrages de science-fiction, et dans des BD comme “Tintin” d’Hergé. Il y a cet imaginaire du son qui peut tuer.
“Pour tuer par le son, il faut dépenser une énergie considérable alors qu’une simple flèche va faire le travail beaucoup plus efficacement.”
- C’est l’une des dimensions comiques de ton livre, ce catalogue que tu fais de toutes les tentatives militaires de rendre le son létal, pour conclure qu’en fait aucune de ces tentatives n’a vraiment fonctionné.
Oui, ils se sont rendus compte qu’il y avait des outils bien plus pratiques que le son pour tuer. Parce que l’arme sonore a comme inconvénient qu’elle peut aussi parfois tuer la personne qui envoie le son, l’opérateur du son. Et puis pour tuer par le son, il faut dépenser une énergie considérable alors qu’une simple flèche va faire le travail beaucoup plus efficacement. Donc le son peut tuer, oui, mais alors dans des conditions qui sont vraiment très peu pratiques d'un point de vue militaire, et encore moins d'un point de vue policier. Mais en fait ce fantasme du “son qui tue” est resté dans l'imaginaire collectif, et ce qui est intéressant, c’est que la peur que ces armes sonores inspirent fait partie de leur efficacité aussi. L’idée était donc aussi de désamorcer cet imaginaire, et de donner des outils de résistance en disant “Attention, effectivement le LRAD c'est dangereux, mais pas parce que ça va complètement retourner votre cerveau : c'est dangereux parce que ça va cibler l'oreille moyenne, ça peut mutiler vos oreilles”. Il s’agissait ainsi d’informer sur la vraie nature du risque et d’éviter les fantasmes.
- Est-ce qu’il y a aussi l’idée d’informer les personnes impliquées dans des luttes sur les armes de répression qui peuvent être utilisées contre elles ?
Oui, donner des outils de résistance. Mais ce n’est pas un bouquin de recettes pour autant. Je dis ça parce qu’un jour un auteur m’a reproché qu’à la lecture de mes livres on avait du mal à savoir où je me situais. Ce que j’ai eu du mal à comprendre, parce que d’un autre côté un blog policier avait recensé mon bouquin en lui trouvant de l’intérêt, mais en ajoutant “Bon, malheureusement l’autrice est d’extrême gauche” ! Cela dit, j’essaye de donner des outils dont les gens puissent se saisir de différentes manières, pour leur permettre de développer une “écoute critique”. Il y a mille manières d’analyser les armes acoustiques, moi je donne la mienne, mais je ne veux pas l’imposer. Et surtout je mets sur la table tout ce que j’ai trouvé au cours de ma recherche. Ma démarche est celle d’une invitation à l’émancipation. Je me situe clairement dans la critique sociale. Bien d’autres ouvrages, notamment anglo-saxons, font ce travail d’analyse des sons comme étant pris dans des rapports de domination capitaliste. Ceci étant dans d’autres régimes totalitaires, le son a aussi pu être utilisé comme force de coercition, donc le problème n’est pas exclusivement capitaliste. Mais dans nos sociétés, c’est la forme de domination qui s’exerce. Donc l’objectif est de montrer les coulisses d’une coercition, pour derrière ouvrir de nouvelles pistes d’action.
- Dans la présentation de cet ouvrage il est écrit que tu es “chercheuse indépendante”. Cela veut-il dire que tes recherches ne se font pas dans le cadre académique d'une université ? Et question complémentaire : quelle a été ta formation scolaire et universitaire ?
J’ai fait une Prépa littéraire, j’ai raté le concours de Normale Sup, puis j’ai fait une maîtrise en Langues, lettres et civilisations étrangères, en anglais, sur l'extrême droite dans la Grande-Bretagne de l’époque, les années 1990. Il y avait donc déjà un ancrage social et politique dans mon travail, même si je ne l'avais pas forcément formulé comme tel à l'époque. Après avoir fait cette maîtrise et l’avoir bien réussie, j'en ai juste eu ras-le-bol du milieu universitaire et je me suis barrée. Je suis arrivée au son des années plus tard. Donc dans le domaine sonore je suis autodidacte, mais en termes d'outils de réflexion et d’analyses je ne le suis pas : j'ai été formée par le système universitaire français, que j’ai mis de longues années à déconstruire totalement. Récemment, j’ai brièvement enseigné dans le laboratoire d’art sonore de Paris 8, grâce au soutien de Matthieu Saladin qui y est maître de conférences et artiste. Mais les conditions administratives et économiques imposées aux vacataires étant parfaitement déplorables, j’ai arrêté. Avec Matthieu et les musiciens Jérôme Noetinger et Francisco Merino, nous avons fondé le collectif Les Sirènes. On travaille ensemble à produire des objets protéiformes de critique sociale du son

Visuel du collectif Les Sirènes.
Concrètement, au quotidien je n’ai aucun financement pour mes recherches, ni aucune directive à suivre. Je fais ce que je veux, comme je veux, sans autre cadre que celui que je me fixe. Je suis un peu rémunérée pour diffuser ma recherche à travers des publications ou des conférences. C’est le modèle inverse de l’Université, qui paye la recherche (très mal) mais quasiment pas sa diffusion. C’est un choix à la fois contraint et volontaire de ma part. Contraint, parce qu’après plusieurs années de précarité, j’ai tenté de renouer avec le milieu universitaire dans l’espoir de trouver une certaine sérénité dans mon travail et puis j’ai vite compris que cela n’allait pas être possible. Dans une institution où les gens m’accueillaient les bras ouverts directement au niveau doctoral, le directeur administratif m'a dit par exemple qu’il fallait que je reprenne mes études pour avoir les bons diplômes dans mon domaine, malgré mes 10 ans de recherche indépendante et une reconnaissance y compris à l’international.
“Ce n’est pas envisageable pour moi de faire financer ma recherche sur le design sonore par une collectivité territoriale ou une entreprise, qui y ont un intérêt direct. Je ne suis pas là pour améliorer la machine à diffuser des sons, mais pour susciter un déplacement de l’écoute et transmettre des outils d’émancipation collective.”
Plus fondamentalement, mon travail est pluridisciplinaire et n’entre pas vraiment dans le cadre universitaire : mes champs et mes outils d’analyse sont très variés, trop peut-être pour l’Université. Parfois ce sont les outils de l’art sonore qui vont me servir, d’autres fois ce sont les outils de la critique littéraire, à d'autres moments je vais aller piocher ailleurs, dans la technique ou dans la science. Depuis quelques mois, par exemple, je me forme à la Langue des Signes Française et je me documente sur la culture sourde. Je ne sais encore où cela va me mener, mais je sais que je dois le faire. Autre difficulté, enfin, je tiens farouchement à mon indépendance éditoriale. Ce n’est par exemple pas envisageable pour moi de faire financer ma recherche sur le design sonore par une collectivité territoriale ou une entreprise, qui y ont un intérêt direct. Je ne suis pas là pour améliorer la machine à diffuser des sons, mais pour susciter un déplacement de l’écoute et transmettre des outils d’émancipation collective.
Bref, aussi bien au niveau administratif qu’en termes de pratiques de recherche, je ne rentre pas dans les cases. Il y a de nombreuses personnes qui résistent de l’intérieur des universités, pour leurs conditions de travail et celles des autres. Je n’ai pas cette énergie-là, en revanche j’ai celle d’explorer mille chemins de traverses. Entre avoir à lutter contre la précarité et avoir à lutter contre l'administration, je préfère encore la précarité, qui me laisse libre de choisir mes pratiques de recherche et d’écriture. Reste que c’est très important pour moi d’être en dialogue avec des universitaires et j’apprécie de participer à des colloques ou des journées d’étude pour cette raison-là : apprendre de leurs outils et transmettre les miens. Tisser des liens transversaux entre les statuts, les disciplines, les pratiques.
- Ce statut de chercheuse indépendante, s'il est peut-être gage d'une plus grande liberté dans la façon dont tu mènes tes recherches et dont tu rédiges tes ouvrages, j'imagine que c'est aussi plus précaire que celui d'universitaire...
En plus du statut de chercheuse indépendante, il y a aussi celui de femme. Je pensais au départ que mon goût pour la recherche indépendante venait de mon ancrage dans les médias libres : cette idée qu’on utilise tous les outils dont on a besoin à un moment donné, qu’on s’auto-forme si nécessaire, qu’on casse les filtres et les hiérarchies habituelles. Mais j’ai compris ensuite que c’était aussi une démarche féministe. L’accessibilité de ma recherche est primordiale à mes yeux : à la fois dans ma manière de m’exprimer et dans le choix des supports que j’utilise. Il m’est par exemple arrivé de refuser de contribuer à un projet éditorialement très intéressant mais dont l’aboutissement était une série numérotée de vinyles à 100 € pièce. Je veux m’adresser à tout le monde et pas juste aux gens qui ont les ressources culturelles pour acheter des vinyles et les ressources économiques pour mettre 100 € dans ce bel objet. Dans la façon dont j’exprime les choses, j’utilise toujours un langage le moins jargonneux possible. Dès que je me mets à jargonner, je sais que c’est parce que mon idée n’est pas encore assez bien pensée et formulée. Dans certains milieux élitistes, le jargon est brandi comme preuve d’une intelligence supérieure. Je pense au contraire que le jargon fait partie d’un travail de représentation de soi-même, qui se produit au détriment du travail de recherche. Pendant des années, je me suis interrogée sur ma légitimité à parler de certains sujets. Je me disais “Si je m’exprime normalement, c’est peut-être que ce que je suis en train de dire est complètement nul”. Maintenant c’est devenu un acte conscient et militant de m’exprimer le plus clairement possible, de faire l’effort d’une accessibilité permanente de ma recherche.
“Comme disait un slogan il y a une vingtaine d’années : ne haïssez pas les médias, soyez les médias. Ne haïssez pas la recherche, soyez la recherche !”
J’ai formalisé cette démarche-là à travers des rencontres avec des chercheuses féministes. Notamment le collectif Oor Records, collectif de recherche féministe et musical suisse qui a fait une conférence sur le silence utilisé comme outil de répression politique. Elles ont une réflexion très riche sur comment mener une recherche en tant que femmes et en tant que féministes. Je trouve toujours stimulant de penser en ces termes-là. C’est aussi ce que fait Salomé Voegelin, qui dans ses conférences-performances met en scène ses conditions de travail déterminées par son statut de femme : pas de lieu de travail dédié, débrouille permanente… Je ne me sens plus illégitime maintenant à prendre la parole et à me sentir libre d’inventer des manières de chercher, de structurer et de diffuser ma recherche. Dans Le son comme arme je voulais inclure une bibliographie de 40 pages, et comme l’éditeur n’a pas voulu la mettre à cause de la longueur, j’ai demandé à ce qu’elle soit publiée en pdf en accès libre sur le site. Pour moi c’est important de montrer l’ensemble de mes sources, et de casser cet effet de domination par l’usage de sources uniquement approuvées. C’était aussi une manière de dire que de façon totalement indépendante, en utilisant majoritairement des sources trouvables en ligne, on peut construire une recherche aussi exigeante que dans un cadre institutionnel. Même si par moments, j’aurais bien aimé partir au fin fond du Massachusetts pour avoir accès à des archives qu’on me proposait de consulter, ce qui n’a pas pu se faire par manque de moyens. Mais voilà, l’idée est de remettre mes sources dans le domaine public, sous-entendu “si vous voulez faire de la recherche indépendante, sentez-vous légitime à le faire”. Comme disait un slogan il y a une vingtaine d’années : ne haïssez pas les médias, soyez les médias. Ne haïssez pas la recherche, soyez la recherche !
- Pour revenir à cette question du rapport entre son et recherche, j'ai l'impression que le son et la radio ne sont pas des champs très explorés par l'Université en France. Est-ce que je me trompe ? Est-ce différent dans d'autres pays ?
Il y a eu le développement dans les pays anglo-saxons des Sound Studies, des études sur le son. Ce champ-là a émergé dans les années 1990 en Amérique du Nord. L’un des grands représentants, Jonathan Sterne, est chercheur dans une université de Montréal. En France il n’y a pas de champ disciplinaire structuré dans le domaine du son, mais de nombreux laboratoires de recherche qui le travaillent, chacun à sa façon, comme celui de Paris 8. Il y a aussi un laboratoire au sein de l’Université d’Amiens, qui a organisé un grand colloque il y a 3 ans sur les “Sound Studies” à la française. Il faut mentionner aussi le laboratoire du Cresson à l’école d’architecture de Grenoble : c’est un laboratoire qui réfléchit à la question du son et du végétal dans l'architecture et l'urbanisme. Ils sont associés à un autre laboratoire à Nantes. Il y a aussi les instituts comme l’Ircam.
La radio est un champ d’étude très distinct des “Sound Studies” : cela se croise très peu, comme d’ailleurs au niveau de la production. Les gens de radio croisent peu les personnes de l’art sonore, il y a des chapelles assez fermées, il est difficile de les faire dialoguer. La radio est notamment enseignée au CUEJ, centre de formation des journalistes à Strasbourg, avec un professeur comme Christophe Deleu, qui travaille sur un objet assez précis, le documentaire. Il y a aussi le Creadoc à l’Université de Poitiers, ainsi que les écoles d’art qui s’intéressent au son, certain.es plasticien.nes développant une pratique sonore. C’est une tendance qui a cours depuis plusieurs années. Et puis il y a une ouverture au son à l’Ecole Louis Lumière notamment. Après c’est un champ qui demeure très disparate. Ce qui laisse pas mal de libertés aussi. Sur la question du son et de la radio, il y a une production éditoriale grandissante en France, même si des gens comme Peter Szendy, Daniel Deshays ou Michel Chion écrivent sur le son depuis plusieurs décennies. Les éditions La Découverte ont alimenté pendant quelques années une collection “Culture sonore” en coédition avec la Philharmonie de Paris. Il y a aussi les éditions Hippocampe, parfois les éditions Le mot et le reste et, en Suisse, la collection Rip On/Off des éditions Van Dieren. Sans oublier les revues très stimulantes que sont Tacet, Audimat ou Revue & corrigée.
“Quand Emmanuel Laurentin m’avait invitée sur France Culture dans son émission La Fabrique de l’Histoire, il avait commencé en disant qu’il avait longtemps cru que j’avais inventé ce personnage, tant les traces qu’il a laissées dans l’Histoire officielle étaient réduites.”
- Revenons à tes recherches et à tes ouvrages. Ce qui est enthousiasmant, pour tes lecteurs, c'est qu'on a l'impression que tu défriches des zones inexplorées. Et que ton travail permet de découvrir ou de remettre en lumière des phénomènes et des personnages oubliés de l'Histoire, comme Harold Burris-Meyer, le personnage central de ton second livre, Contrôle, paru en 2017 à la Découverte.
Harold Burris-Meyer c'est un personnage sur lequel j’avais écrit deux lignes dans mon premier livre, Le Son comme arme. J'y expliquais qu’il avait travaillé sur un projet de torpille acoustique pour l’armée des USA au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il a traversé les milieux du théâtre, de la musique d’ambiance et de la recherche militaire, mais comme personnage il avait été totalement oublié. Je me souviens que quand Emmanuel Laurentin m’avait invitée sur France Culture dans son émission La Fabrique de l’Histoire, il avait commencé en disant qu’il avait longtemps cru que j’avais inventé ce personnage, tant les traces qu’il a laissées dans l’Histoire officielle étaient réduites. Après je me défie du discours de la “nouveauté” : c’est comme l’histoire de la “découverte” de l’Amérique. Ce n’est pas parce qu’une réalité n’a pas encore été perçue par nous ou les gens qui sont situés dans le même milieu que nous qu’elle est nouvelle. La musicologue Suzanne Cusick avait par exemple déjà travaillé sur la torture par la musique. Dans le champ francophone, ceci dit, avec Le son comme arme j’ai ouvert un champ de recherche très spécifique : j’étais la personne qui pouvait faire la synthèse de ce truc-là parce que j’étais au bon croisement, au bon moment.
Pour Burris-Meyer, le héros de mon second livre, ce qui m’a passionnée, c’est de reconstituer sa trajectoire extrêmement métaphorique d’une évolution du “capitalisme sonore”, pour reprendre l’expression de l’un des professeurs qui a succédé au poste de Meyer aux USA, et que j’ai interrogé pour l’ouvrage.
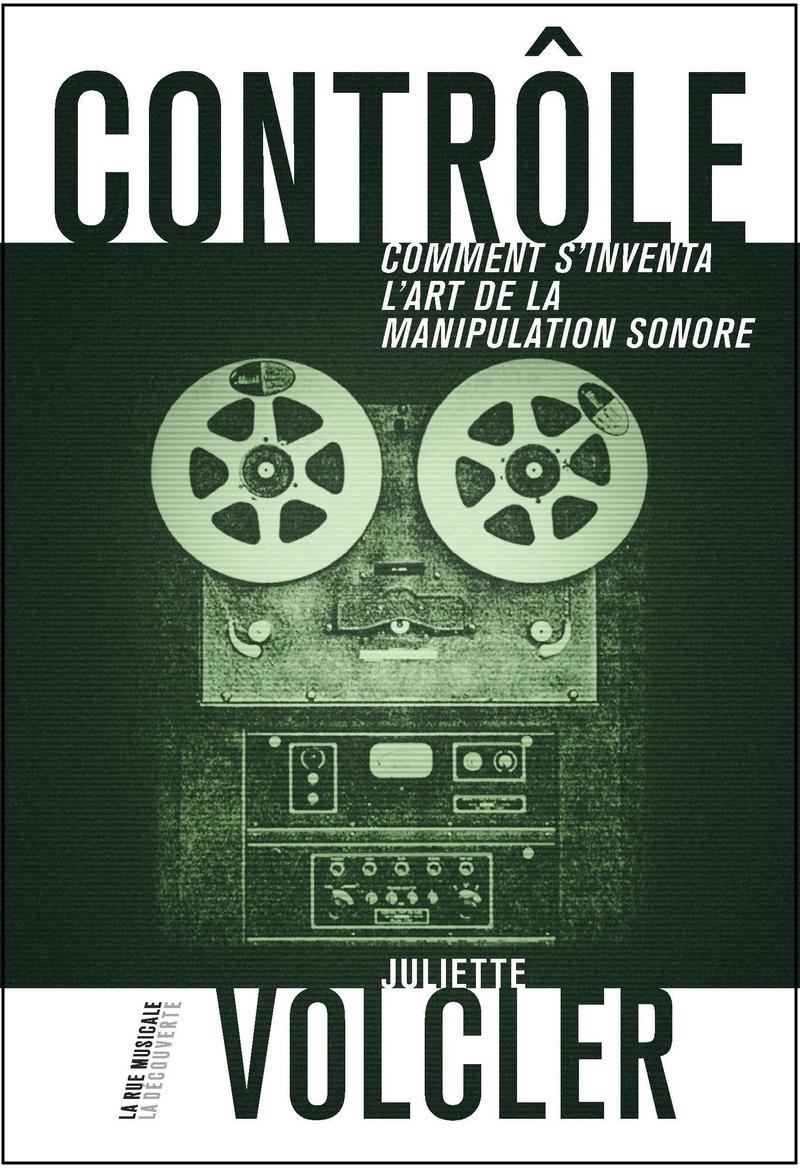
- Pourquoi as-tu choisi de centrer ton ouvrage sur Burris-Meyer, au lieu de faire un travail plus général sur l'histoire de la "manipulation sonore" ?
Parce que le parcours de cet homme est une sorte de parabole quasi parfaite. Au lieu de prétendre faire un travail exhaustif sur une généalogie du capitalisme sonore, ou des tentatives d’utiliser le son comme outil de contrôle social, je me suis dit qu’en zoomant sur ce personnage je parviendrais à retracer cette histoire de manière plus intéressante. Je voulais me concentrer sur les ambitions de cet homme, et sur sa naïveté (une naïveté pas forcément sympathique), sa croyance idéaliste dans les grandes possibilités manipulatrices du son. Je souhaitais voir où cela me mènerait. D’ailleurs en ce moment j’écris un bouquin sur le design sonore, et là pareil, l’approche “macro” me semble impossible. Je procède donc de la même manière, en agrégeant des fragments entre eux. C’est aussi ma manière de penser, en passant par les détails, plutôt qu’en tentant des théories d’ensemble, englobantes. Burris-Meyer a été représentatif de la majorité des gens de son époque, mais il a quand même été oublié par l’Histoire, et même à son époque était considéré comme une personnalité de second plan par ses interlocuteurs. Un jour, lors d’un débat sur le livre, quelqu’un dans le public m’a dit “Mais on dirait que vous le trouvez sympathique ce personnage”. Oui, bien sûr que je le trouve sympathique, même si je suis en total désaccord avec lui.
“Toute personne qui aime écouter des basses à fond près d’une enceinte peut être touchée par Burris-Meyer. Toute personne qui aime écouter de la musique pour se relaxer peut aussi être touchée par Burris-Meyer. Touchée ou déstabilisée...”
Comme dans Le son comme arme je voulais fournir des outils d’écoute critique plutôt qu’une sorte de recette prête à l’emploi. Pour Contrôle, ce qui m’intéressait c’était d’avoir un rapport ambivalent à ce personnage. Il a quand même inventé le spectacle sonore dans les années 1930, avec une volonté de mettre au premier plan ses innovations sonores, au détriment de la mise en scène visuelle. Dans un premier temps, il n’a pas cherché à manipuler le public par le son, il était simplement dans un rapport émerveillé au son, et toutes les innovations qui pouvaient en découler : et cet enthousiasme-là moi aussi je le connais. Il était très militant, disant que le son était trop considéré comme le parent pauvre au théâtre, et que le visuel était valorisé outre mesure : je me retrouve aussi dans ce genre de prise de position. C’est après que ça diverge totalement. Cette sympathie que l’on peut avoir pour ce personnage m’intéresse parce qu’elle questionne nos ambivalences dans notre rapport au son. Toute personne qui aime écouter des basses à fond près d’une enceinte peut être touchée par Burris-Meyer. Toute personne qui aime écouter de la musique pour se relaxer peut aussi être touchée par Burris-Meyer. Touchée ou déstabilisée, car au fond, si j’aime que les basses me donnent de l’énergie ou que la musique classique me calme, qu’est-ce qui me différencie de lui ? Pourquoi serait-il risible ou condamnable et moi non ? J’aime les démarches susceptibles de faire bouger nos a priori, de nous déplacer, de nous remettre en question, de nous faire réfléchir à nos pratiques du son. Assumer l’ambivalence tout en ayant un positionnement politique et social clair, ça me semble important.
“J’ai trouvé des informations inespérées en allant sur des forums de généalogie. Trouver ce genre de pépites à des endroits où une chercheuse n’est pas censée aller, c’est formidable.”
- Peux-tu nous parler des différentes sources documentaires auxquelles tu vas puiser pour l’écriture de tes livres ?
Le son comme arme était encore assez journalistique dans la démarche, même s’il y a déjà une ironie assez présente. Pour Contrôle j’avais envie de faire quelque chose de plus littéraire dans l’écriture. La littérature permet d’aller plus loin, de saisir le réel avec plus de nuances et plus d’épaisseur. Déjà dans Le son comme arme, j’utilisais des sources très différentes : ça pouvait être des articles de journaux de 1962, ou bien des extraits de thèses très récentes, mais aussi des rapports militaires… Et pour Contrôle j’ai encore plus mélangé les sources. J’ai trouvé des informations inespérées en allant sur des forums de généalogie : une jeune femme y parlait de son grand-oncle et de ses inventions. Et j’hallucinais, je me disais “non, elle ne parle pas du même, ce serait trop beau”, et en fait si, comme je l’ai vérifié en faisant un travail de recoupement. Trouver ce genre de pépites à des endroits où une chercheuse n’est pas censée aller, c’est formidable. J’aime beaucoup mélanger des sources dites sérieuses, universitaires, et des sources dites “grises”, pas considérées comme fiables. Pour moi, d’ailleurs, les sources officielles sont souvent pleines de biais, à vérifier et à recouper aussi scrupuleusement qu’un forum. Le fait d’écrire ensuite, c’est un exercice d’équilibriste qui ne doit pas oublier les biais ou les chausse-trapes de tes sources d’information. La liberté d’écriture que j’ai prise, la forme narrative, m’a permis de comprendre beaucoup plus de choses dans l’émergence des usages du son comme outil de contrôle social. Et de ne jamais dissocier la recherche technique de l’imaginaire dans lequel elle est prise. Un imaginaire d’autant plus difficile à aborder que j’en suis moi-même totalement imprégnée, je ne peux pas l’observer d’un dehors censément neutre.
- Après le son comme moyen d'oppression ou de coercition avec Le son comme arme, tu as travaillé sur le son comme moyen de manipulation avec Contrôle. D'où te vient à ton avis, cette façon d'envisager le son sous l'angle du soupçon ?
En arrivant au son par la radio libre, j’ai d’abord associé le son à l’idée d’émancipation. Ça s’est renforcé quand j’ai découvert la création sonore et que son écoute comme sa production m’ont énormément apporté. Pour moi c’était une surprise de réaliser que des gens avaient voulu utiliser le son comme une arme, avec presque une forme d’indignation : “Comment pouvait-on vouloir faire ça au son ?”. Ensuite j’ai compris que cette indignation-là était une grosse erreur. Jonathan Sterne parle de litanie audiovisuelle à propos des valeurs qu’on attribue au son et à l’image comme si elles leur étaient intrinsèques, alors qu’elles sont culturellement construites. Les entreprises privées ou les institutions qui exploitent le son aujourd’hui ont ce discours sur le caractère bénéfique du son, sur l’intimité qu’il permettrait, sur l’immersion. L’émergence du design sonore dans l’espace public, c’est ça : on veut faire des beaux sons censément pour améliorer la vie des gens. Il n’y a rien qui m’exaspère plus les oreilles qu’un bonbon sonore qu’on nous sert de force dans l’espace public. Le son n’est pas bon en tant que tel, ni mauvais en tant que tel. C’est son contexte de production et de réception qui peut être libérateur ou asphyxiant.
“Dans le domaine du son, par exemple, Volkswagen a financé toute une campagne nommée “The fun theory” dont l’idée était qu’à travers un élément sonore “drôle” on peut inciter les gens à faire le ‘bon choix’. ”
Dans les milieux de la production sonore et radiophonique il y a une forte adhésion à ce discours marketing. Le discours “le son c’est le bien” est pour moi cauchemardesque : c’est ce qui va justifier aussi bien le développement de la publicité audio dans les podcasts industriels que le recours abondant au design sonore de la part des fabricants de Smartphones, de voitures électriques ou des régies de transports en commun. Cet usage du son est une autre façon d’exercer un contrôle social, et a pour moi sa source dans une pensée fonctionnaliste, comportementaliste, selon laquelle le son doit être utilisé pour orienter les gens là où l’on veut qu’ils aillent. Cela a été énoncé de manière claire dans l’ouvrage Nudge de Cass Sunstein et Richard Thaler, auteurs qui se définissent comme des “paternalistes libertariens”, une expression positive à leurs yeux. L’idée étant qu’il y a une classe dirigeante, savante, qui a bon goût et qui sait ce qui est mieux pour l’ensemble de la société, que ce soit pour le choix d’un plat à la cantine ou celui de tel ou tel couloir dans le métro. Leur livre serait presque comique s’il n’était pas appliqué massivement par les collectivités locales, parce que c’est une manière très économique de réagencer l’espace public. Dans le domaine du son, par exemple, Volkswagen a financé toute une campagne nommée “The fun theory” dont l’idée était qu’à travers un élément sonore “drôle” on peut inciter les gens à faire le “bon choix”, même s’ils ont toujours le droit de faire le “mauvais choix” puisqu’on est en démocratie. Par exemple, les escaliers dont chaque marche produit une note de piano quand on marche dessus (il y en a un dans un centre commercial à Boulogne-Billancourt), c’est pour inciter les gens à prendre l’escalier plutôt que l’escalator.
- Le nudge sonore serait en quelque sorte l’équivalent sympa du mosquito, le répulsif dont on parlait tout à l’heure
Oui, c’est exactement ça. Derrière cette bienveillance affichée, il y a un jugement moral très fort et une conception parfaitement mécaniste et inégalitaire de l’ordre social. Cela permet de prédéfinir au maximum les usages possibles d’un espace public. Non pas comme dit Henry Torgue (membre du laboratoire de recherches CRESSON à Grenoble), en favorisant une improvisation permanente et harmonieuse de chacun·e, mais en traçant des chemins invisibles dans l’espace public. Le phénomène du nudge m’intéresse parce qu’il m’aide à affiner mon “écoute critique”. Cette pratique de l’écoute critique, c’est d’ailleurs ce qui relie deux activités que j’ai longtemps menées en parallèle en pensant qu’elles étaient à l’opposé l’une de l’autre : l’écriture de mes livres sur le son comme moyen de répression ou de contrôle social, et l’écriture d’articles pour Syntone sur des sons que j’écoutais avec beaucoup de plaisir, des créations sonores et documentaires. L’écoute et l’analyse des sons et du monde sonore me passionne.
“Ce qui est passionnant, c’est le mix entre les nudges sonores et les sons inattendus que produit la ville en permanence. Comment le réel va sans cesse déjouer les machines ou les insérer dans un ensemble qui les dépasse totalement.”
Je suis arrivée au son par la production radiophonique et j’ai découvert l’écoute beaucoup plus tard en réalité, et après c’est l’écoute qui est devenue ma pratique principale et centrale. Et j’ai aussi à coeur de transmettre ces outils d’écoute critique que j’ai développés à travers ces différentes activités. C’est d’autant plus important à l’heure actuelle, au moment où des productions sonores industrielles se développent massivement : en venant ici en métro, j’ai croisé deux affiches en 4x3 qui faisaient la publicité pour des livres audio. Le discours publicitaire sur “l’évasion par le son et l’audio” s’est encore renforcé depuis le confinement. La notion d’écoute critique me semble importante pour mieux se repérer dans notre monde sonore : elle permet de faire le distingo entre un son publicitaire et un son qui ne l’est pas, et de reconnaître une création qui respecte l’auditeur.ice, qui lui laisse une vraie place, contrairement à des productions industrielles qui l’enferment dans un rôle extrêmement restreint, un rôle de “consommateur.ice d’audio”. L’écoute critique permet de déjouer ces schémas, et de se placer en observatrice.eur des coulisses. C’est pour ça que finalement j’aime assez les musiques d’ambiance dans l’espace public : parce qu’à travers le choix de telle musique et l’emplacement des haut-parleurs, elles me racontent beaucoup de choses sur les croyances et les espoirs des gens qui les diffusent. Certains mettent des casques audio diffusant leur musique ou leurs sons pour se prémunir de ces pièges sonores omniprésents ou de cette surcharge auditive. Moi, je prends le parti inverse, je me promène les oreilles grandes ouvertes pour analyser les publicités sonores, le marketing sonore territorial, comme les annonces de tramway. Et ce qui est passionnant, c’est le mix entre ces nudges sonores et les sons inattendus que produit la ville en permanence. Comment le réel va sans cesse déjouer les machines ou les insérer dans un ensemble qui les dépasse totalement.
“Syntone a investi un champ assez inexploré : celui de la critique sonore. Alors que la critique littéraire est quelque chose de très ancré dans la culture française, la critique sonore l’était très peu.”
- En 2012 tu as commencé à collaborer à Syntone, revue Web et papier, dont tu es devenue la coordinatrice éditoriale en 2014. Parle nous de cette aventure Syntone, revue de l'écoute qui a duré dix années et qui a cessé son activité en 2018.
Syntone a été une très belle aventure et c’est toujours un peu difficile d’en parler parce que son arrêt a été une vraie tristesse. On avait une très grande liberté dans le choix des articles et dans la façon d’écrire, et le dialogue entre les contributeurs.trices était aussi passionnant. C’est Etienne Noiseau qui a fondé Syntone et qui l’a portée. Il a trouvé les moyens financiers pour assurer des publications régulières, en payant des piges aux contributeurs.trices, ce qui était aussi une forme d’expérimentation sociale, puisque beaucoup d’entre nous avions un statut précaire et n’étions pas toujours payé.es pour nos autres activités autour du son ou de la radio. D’un point de vue éditorial Syntone a investi un champ assez inexploré : celui de la critique sonore. Alors que la critique littéraire est quelque chose de très ancré dans la culture française, la critique sonore l’était très peu. On a voulu le faire avec beaucoup d’exigence. C’est à travers Syntone que j’ai commencé à travailler sur l’histoire de la création sonore. On pouvait passer beaucoup de temps à écouter des créations et à les analyser, et à réussir à trouver comment écrire cette nouvelle forme de critique.
- Et ton rôle de coordinatrice éditoriale de Syntone, en quoi consistait-il ?
Avec Etienne, on discutait de la ligne éditoriale des sujets qui nous semblaient importants. On passait aussi des commandes de chroniques à des auteurs et des autrices. On accompagnait leur travail d’écriture, parce que certain.es étaient peut-être plus habitué.es à l’expression par le son qu’à l’expression écrite. Il y avait le travail de comité de rédaction propre à toute revue. Syntone c’était une “zone autogérée d’écoute de la création sonore”. On affirmait que c’était un vrai métier, que ce n’était pas quelque chose de secondaire. Il y avait, et il y a encore, une histoire énorme qui n’était pas racontée, et qui est jalousement gardée dans les greniers de l’INA, dont les archives ne sortent qu’au compte-gouttes. On voulait contribuer à la constitution d’une culture sonore collective, afin que les différentes chapelles du milieu (art sonore, création radio, documentaire…) commencent à s’apercevoir de l’existence des autres, et de l’enrichissement mutuel qu’elles pouvaient s’apporter. C’était aussi la volonté de faire découvrir au grand public un champ de la création assez méconnu. On a fait un travail auprès de certaines bibliothèques publiques pour leur faire prendre conscience qu’il leur manquait un rayon à propos de la création sonore et radiophonique. Syntone a été créé en 2008 et on a vu apparaître les premières formes de podcast industriel autour de 2015. Le travail qu’on avait fait nous permettait de sentir l’appauvrissement que cette forme de podcast pouvait entraîner : des sons très “pauvres en oreille”, comme on dit d’un vin qu’il est pauvre en bouche. L’une de nos missions a été à ce moment-là de ne pas laisser le marketing et la communication dicter ce qui était bon ou pas dans le domaine de la production radio et sonore.
- Quand on regarde la liste des articles que tu as produits pour Syntone, on voit que tu portes un intérêt à la radio ou au podcast pour la jeunesse ainsi qu'aux productions des radios associatives.
J’ai toujours assuré une veille sur les radios associatives, à une époque à travers le portail le Perce-oreilles qui faisait des sélections d’émissions et de créations librement écoutables sur le web. On a souvent tendance à voir ces radios comme un bac à sable où les gens font leurs armes avant d’aller dans des “vrais” médias (en fait, des médias dominants), mais pour moi ce sont de véritables lieux de création et d’expérimentation sonore. Parfois il y a des maladresses, d’autres fois c’est déjà extrêmement construit et ce ne serait pas mieux fait dans des radios dites “professionnelles”. Le service public assuré par ces radios est essentiel. La mutualisation qu’elles permettent d’outils de production et de diffusion du son est une très bonne chose. L’histoire de ces radios-là et de leur contribution à la création sonore reste encore très largement à écrire.
“Parfois les productions sonores destinées aux enfants sont atterrantes, aussi bien dans l’adresse (les enfants sont pris pour des imbéciles) que dans la forme : ce sont des publicités à peine déguisées, des effets à la truelle ou un montage de clichés sonores, comme de la malbouffe pour les oreilles.”
Quant aux productions sonores pour la jeunesse, elles ont longtemps été considérées comme un objet de second plan, alors que pour moi ce sont elles aussi de magnifiques laboratoires de créations et d’expériences. D’abord, politiquement, je pense qu’il est fondamental de s’adresser aux enfants et de nourrir leurs oreilles avec la même exigence qu’on nourrit leurs yeux avec des peintures, des dessins ou des films. Ensuite, la création jeunesse est comme le miroir magique des enjeux de la création sonore au sens large. Des offres d’histoires audio pour les enfants débarquent à flot en ce moment. J’en écoute régulièrement. Parfois ces pièces pour enfants sont atterrantes, aussi bien dans l’adresse (les enfants sont pris pour des imbéciles) que dans la forme : ce sont des publicités à peine déguisées, des effets à la truelle ou un montage de clichés sonores, comme de la malbouffe pour les oreilles. Mais bien d’autres, produites par des associations, des producteurs.trices indépendant·es ou des radios, sont un merveilleux lieu d’invention, de défrichage. La fiction jeunesse expérimente aussi beaucoup de choses au niveau du dialogue entre le son et les images ou le texte imprimé. Un éditeur comme Benjamin Media a une approche très fine de ce rapport : le son n’y est pas redondant par rapport à l’image, qui elle-même ne répète pas ce que dit le texte. Dans un article pour Syntone, j’avais fini par conclure que si la fiction jeunesse était si peu valorisée, c’est parce que le public enfant était considéré comme un sous-public. Mais en réalité une fiction jeunesse demande une exigence plus forte qu’une fiction adulte.
- Depuis un ou deux ans, tu as repris une pratique de production radiophonique, à travers des projets comme l'Acentrale, ou Radio Renversée. Peux-tu nous parler de ces deux expériences qui utilisent le média radio comme une arme, ou comme un moyen de relayer ou de porter des luttes ?
L’Acentrale est née en décembre 2019 pendant la lutte contre la réforme des retraites, avec la volonté de coordonner des personnes, des structures ou des collectifs dont l’objectif commun était de relayer des luttes sociales. “Sons en lutte” avait déjà fait ce genre de travail : c’était une plateforme d’échanges de productions et de sons de luttes sociales entre radios libres. De telle sorte qu’un son de manif enregistré à Lyon par Radio Canut puisse être rediffusé par FPP ou Canal Sud, qui partageaient leurs propres reportages locaux. L’idée de l’Acentrale c’est de documenter par le son les luttes locales, et de mettre la radio au service des luttes sociales. On avait notamment un répondeur sur lequel les gens pouvaient intervenir. On a aussi installé des studios ouverts au sein de luttes locales, notamment en région parisienne, pour qu’un cheminot ou une infirmière en lutte puissent prendre la parole le plus facilement possible.
Ensuite avec une copine, Aude Rabillon, on a décidé de quitter l’Acentrale et de prolonger l’aventure en montant l’émission Radio renversée, qui est diffusée sur ∏Node, l’Eko des garrigues et d’autres radios associatives. Aude Rabillon fait partie du collectif Jef Klak, une revue de critique sociale, de littérature et de création sonore, où les enjeux de création et d’émancipation ne sont pas scindés. C’est aussi ce qu’on essaye de faire avec Radio Renversée : une pièce de création sonore de 10 minutes va pouvoir précéder un entretien autour d’une lutte, avec l’idée que chaque forme peut nous apprendre autant. On n’a pas d’indicatif : on commence toujours par un field recording, de manière à surprendre l’oreille et à déjouer l’écoute. L’idée est de se laisser étonner par l’écoute de quelqu’un d’autre. Le terme de “renversée” vient du fait qu’on voulait une émission où l’on écouterait autant ou plus qu’on ne parlerait. La radio telle qu’on la rêve et telle qu’on l’apprécie, c’est celle où il y a énormément d’écoute dans la production même du son. Et puis politiquement, la notion de renversement nous semble intéressante. En tout cas c’est drôle parce qu’avec ces deux expériences, je me suis remise à faire de la radio, avec beaucoup de plaisir, après une longue période loin des micros et des studios.
- Qu’est-ce qu’il y a comme podcasts ou créations sonores dans tes oreilles ?
Dernièrement, j’ai beaucoup écouté des œuvres sonores de femmes : Mérryl Ampe, Emilie Mousset, Sophie Berger, les recensions du blog Feminatronic ou encore la merveilleuse émission Wi Watt'Heure de Carole Rieussec et Elena Biserna sur Revue et corrigée.
Côté radio, j’écoute majoritairement des radios associatives : les flux de π-Node, des émissions comme Brasero sur Canal Sud, dont j’apprécie beaucoup le côté laboratoire tous azimuts, ou Radia, pour l’ouverture sur la création internationale. Et puis je ne me lasse pas des Nuits de France Culture, de toutes ces pépites que la Maison de la Radio considère appartenir au passé mais qui lui montrent plutôt la voie d’une vraie transformation. Côté podcasts, j’écoute très souvent Métaclassique, de David Christoffel, Paroles d’histoire, et je suis avec beaucoup d’intérêt ce que développe la webradio des arts et du commun R22. J’ai aussi beaucoup aimé une série d’émissions de Radio Pikez autour du salariat, de la notion de travail gratuit, à ce qui est rémunéré ou pas dans le travail. Radio Pikez est une webradio de Brest qui réfléchit beaucoup à la façon de travailler en collectif. Pendant le festival Longueur d’ondes cette année ils avaient invité l’Acentrale à faire une émission à 20 dans un studio minuscule : la parole circulait dans tous les sens, ça a été un moment magnifique, il y avait une énergie folle.
- C’est quoi ton premier souvenir de radio en tant qu’auditrice ?
Si je dois parler d’un moment d’écoute qui est pionnier pour moi, ce n’est pas de la radio. J’habitais dans une grande ville, j’avais la vingtaine, et un jour j’ai décidé de marcher en me concentrant sur l’écoute. Ça a été une balade géniale. Écouter la ville en tournant dans une rue parce qu’un son intéressant en provenait. Ce jour-là j’avais suivi un parcours que je n’avais jamais fait auparavant. Le plaisir de l’écoute, et le fait d’avoir les oreilles toujours grandes ouvertes, ça vient en grande partie de cette promenade, alors que je ne connaissais pas du tout le milieu de la création radio à l’époque ni la pratique du soundwalk.
Propos recueillis par Thomas Guillaud-Bataille le 25 août 2020.

