Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences : « Le décalage entre les dynamiques techniques et économiques et le discours de la transition est gigantesque »
Dans un entretien au « Monde », l’auteur de « Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie » souligne que décarboner nos sociétés en ayant recours à l’idéologie du nouveau capitalisme vert est une mystification.
Propos recueillis par Nicolas Truong
Historien des sciences, des techniques et de l’environnement, Jean-Baptiste Fressoz est chercheur au Centre national de la recherche scientifique et enseignant à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et à l’Ecole des ponts ParisTech. Il a notamment publié L’Evénement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous (avec Christophe Bonneuil, Seuil, 2013), et Les Révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique XVe-XXe siècle (avec Fabien Locher, Seuil, 2020). Il tient une chronique mensuelle pour Le Monde. Dans Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie (Seuil, 416 pages, 24 euros), il remet en cause l’histoire linéaire et « phasiste » de la transition énergétique, qui incarne, selon lui, « l’idéologie du capital au XXIe siècle ».
Pourquoi la transition énergétique, tant annoncée et souhaitée, n’aura-t-elle, selon vous, pas lieu ?
Je suis un historien et je ne suis pas payé pour prédire le futur. L’argument de mon livre n’est pas de dire que la transition est impossible car elle n’a pas eu lieu par le passé. Je propose un regard nouveau sur l’histoire des énergies qui permet d’identifier des facteurs conduisant à leur accumulation. Je constate aussi que l’idée de transition énergétique est récente. Personne ou presque n’en parle avant les années 1970. Et elle ne part pas d’un constat empirique. Elle apparaît dans la futurologie avant d’être reprise par les historiens sans trop de recul critique.
L’histoire a joué un rôle idéologique discret mais central dans la construction de ce futur réconfortant. Si vous y prêtez attention, vous verrez que de nombreux politiciens, et même des experts, font souvent cette analogie : face au changement climatique, il nous faudrait réaliser une nouvelle transition énergétique, voire une troisième révolution industrielle – après la première du charbon et la deuxième du pétrole – fondée cette fois-ci sur les renouvelables et, ou, le nucléaire.
Ce genre de récit « phasiste » du monde matériel ne mène nulle part. L’industrialisation des XIXe et XXe siècles ne peut se prévaloir d’aucune transition. On ne passe pas du bois au charbon et encore moins, bien évidemment, du charbon au pétrole. Non seulement les énergies s’accumulent, ce qui est une évidence statistique, mais cette accumulation est symbiotique.
Qu’entendez-vous par « accumulation symbiotique » des énergies ?
Je pense qu’il faut se garder de penser les énergies comme des entités distinctes et en compétition. La théorie de la « destruction créatrice » de Joseph Schumpeter (1883-1950) est un schéma simpliste qui a été pris bien trop au sérieux par les experts, y compris du climat. Déjà douteuse en ce qui concerne les techniques, elle ne fonctionne absolument pas pour les matières et les énergies. L’histoire matérielle du capitalisme est celle d’une expansion symbiotique de toutes les énergies et de toutes matières.
Par exemple, on raconte la révolution industrielle comme une transition vers le charbon. Or toutes les énergies croissent pendant l’industrialisation : l’hydraulique, le muscle humain et animal, de même que la consommation de bois. Pour étayer les galeries de ses mines de charbon, l’Angleterre utilise plus de bois en 1900 qu’elle en brûlait en 1800. Et comme c’est du bois d’œuvre, on parle de surfaces forestières bien plus importantes.
De même, au XXe siècle, le pétrole stimule la consommation de charbon. Il est extrait avec des tubes en acier, brûlé dans des moteurs en acier, qui font avancer des machines en acier, et tout cet acier dépend au premier chef du charbon. Un dernier exemple : même si l’électricité souffle les mèches des lampes à pétrole au XXe siècle, les seuls phares des voitures consomment actuellement plus de pétrole que le monde entier en 1900.
D’où vient cette croyance contemporaine en une succession de phases énergétiques selon laquelle nous serions passés de l’ère du charbon à celle du pétrole, et que le renouvelable supplanterait à terme le fossile ?
Le problème est qu’on a eu tendance à plaquer l’histoire des techniques où des substitutions peuvent exister (du pétrole à l’électricité, pour reprendre l’exemple précédent) sur l’histoire matérielle qui, elle, est strictement additive. En 1928, un forestier le disait avec concision : « Les matières premières ne sont jamais obsolètes. » Le XXe siècle lui a pour le moment donné entièrement raison : l’éventail des matières premières consommées s’accroît, et chacune – hormis quelques exceptions – l’est en quantités croissantes.
Pour quelles raisons la transition est-elle, comme vous le concluez, « l’idéologie du capital au XXIe siècle » ?
Parce qu’elle évite de parler de niveau de production et de répartition. A cause de, ou grâce à, la transition, on parle de technologies complexes plutôt que faire des choses simples tout de suite : on rêve d’avion à hydrogène, plutôt que de réduire le transport aérien, de ciment vert plutôt que d’arrêter de construire de nouvelles routes. A cause de la transition, la décroissance a été laissée dans un état de friche intellectuelle par les économistes.
Mon livre n’est ni contre les renouvelables ni contre l’innovation. Bien au contraire. Mais il faut reconnaître qu’avant 2050, le délai imparti par le défi climatique, il est très peu probable qu’on puisse décarboner des secteurs majeurs comme les transports aérien et maritime ou ceux de l’acier, du ciment, des engrais ou du plastique. Ce n’est pas forcément une question d’impossibilité technologique – on peut faire voler des avions avec de l’huile végétale –, mais de mise à l’échelle, de temps de diffusion et de « bouclage matière ».
Je remarque aussi que, depuis trente ans, « l’intensité carbone » de l’acier stagne, que celle du ciment augmente, qu’à l’échelle mondiale l’agriculture dépend davantage des fossiles, de même que l’urbanisation ou encore les chaînes de valeur qui se sont globalisées. Je consulte enfin avec inquiétude les prospectives réalisées par l’Agence internationale de l’énergie, qui n’entrevoit aucune sortie des fossiles pour 2050, mais leur stagnation. Le décalage entre les dynamiques techniques et économiques et le discours de la transition est gigantesque, et j’ai peur que ce dernier n’ait contribué à endormir, et à dépolitiser, la question climatique.
« Sans transition » prolonge les intuitions théoriques et les travaux historiques menés depuis votre premier livre, « L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique » (Seuil, 2012), dans lequel vous menez une critique de l’idée d’une soudaine prise de conscience générationnelle des enjeux écologiques…
Il y a effectivement un fil rouge dans mon travail. Une des choses qui ne cessent de m’étonner est l’extraordinaire présentisme qui entoure les questions environnementales. On le voit au trope de la « prise de conscience » répétée après chaque catastrophe. En sciences sociales, ce sentiment, au fond gratifiant, d’être la première génération « à prendre conscience » s’est formalisé dans des livres influents comme La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité(Flammarion, 2008) du sociologue allemand Ulrich Beck (1944-2015), qui explique que la modernité est devenue « réflexive », une thèse prolongée par le philosophe français Bruno Latour (1947-2022), avec son idée de « fin de la parenthèse moderne ».
Dans « L’Apocalypse joyeuse », je montrais que l’environnement était en réalité bien plus important au tournant des XVIIIe et XIXe siècles que pour nous maintenant. Pour une raison simple : il s’agissait d’une catégorie centrale en médecine. En l’absence de théorie microbienne, les « choses environnantes » (eau, air, lieu) définissaient la santé des populations et même la forme des corps. Leur altération par la pollution pouvait provoquer épidémie et dégénérescence.
Mais, à vous lire, la question climatique est également présente depuis longtemps, et même dès le XVIe siècle. Sous quelle forme ?
Elle est présente depuis bien plus longtemps qu’on ne le pense. Dans Les Révoltes du ciel, coécrit avec l’historien des sciences Fabien Locher, nous avons montré combien la crainte d’un changement anthropique des climats causé par la déforestation avait été un sujet politique et scientifique brûlant en Europe. Selon une vision créationniste de la planète, « déforester » revenait à attenter au plan divin, celui d’un cycle global de l’eau assurant la stabilité climatique.
Exhumer ces savoirs et ces débats permettait de remettre en question notre sentiment rassurant de prise de conscience. Il faut reconnaître que les sociétés du passé n’ont pas transformé leurs environnements par inadvertance. L’histoire environnementale, telle que je la racontais, n’était pas celle d’une prise de conscience, mais celle de la fabrication d’une certaine inconscience modernisatrice, d’une forme de « désinhibition » face au risque. L’idée de transition énergétique en fournit sans doute un excellent exemple.
C’est le mot magique de l’ère écologique, le sésame des environnementalistes, le graal industriel du capitalisme vert : la transition énergétique est devenue l’horizon indépassable de notre temps. Or voici qu’un historien des sciences dynamite cette croyance aussi bien répandue chez les politiques que chez certains activistes, chez les ingénieurs qu’auprès des entrepreneurs.
Dans Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie (Seuil, 406 pages, 24 euros), Jean-Baptiste Fressoz se livre en effet à une critique implacable de l’histoire « phasiste » des énergies. Celles-ci se sont accumulées et ne se sont pas substituées les unes aux autres à travers une succession de « phases » et de périodes historiques. Nous ne sommes pas passés de l’âge du bois à celui du charbon, de l’ère du pétrole à celle du nucléaire et du renouvelable. D’une part, parce que « l’humanité n’a jamais brûlé autant de pétrole et de gaz, autant de charbon et même autant de bois » qu’aujourd’hui, les arbres fournissant encore deux fois plus d’énergie que la fission nucléaire. D’autre part, parce que les énergies s’accumulent de manière « symbiotique », soutient-il : elles sont étroitement liées entre elles, le bois permet d’extraire le charbon, et l’extraction du pétrole est indissociable du béton et même de l’acier – pour les tubes et pipelines – et donc du charbon qui permet de les produire.
C’est l’intrication des énergies et des manières de les produire que Jean-Baptiste Fressoz met au jour dans un ouvrage savant et décapant. Un livre qui fera date dans l’histoire matérielle de l’énergie, mais également parce qu’il est une puissante critique de la principale idéologie de l’écologie.
L’ouvrage marque également les dix ans de la collection « Anthropocène », dirigée aux éditions du Seuil par l’historien Christophe Bonneuil, qui a choisi de la baptiser désormais « Ecocène ». Si « Anthropocène » témoigne de l’héritage de « notre commun négatif » avec la description des ravages de l’extractivisme, dit-il, « Ecocène » sera le lieu d’élaboration des utopies transformatrices destinées à inventer un monde commun partagé avec tous les vivants. Si la transition énergétique n’a jamais eu lieu, comme le dit Jean-Baptiste Fressoz, souhaitons que cette énergique transition intellectuelle soit porteuse d’avenir.
« Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie », de Jean-Baptiste Fressoz (Seuil, 416 p., 24 €).
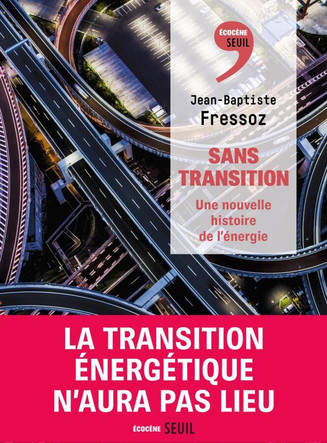 <img src="https://jpcdn.it/img/r/664/443/a27f38405f68bee381cfa2033b9e0aa4.jpg" alt="« Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie », de Jean-Baptiste Fressoz, Seuil, 416 pages, 24 euros.">
« Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie », de Jean-Baptiste Fressoz, Seuil, 416 pages, 24 euros.
<img src="https://jpcdn.it/img/r/664/443/a27f38405f68bee381cfa2033b9e0aa4.jpg" alt="« Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie », de Jean-Baptiste Fressoz, Seuil, 416 pages, 24 euros.">
« Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie », de Jean-Baptiste Fressoz, Seuil, 416 pages, 24 euros.
